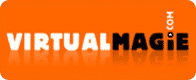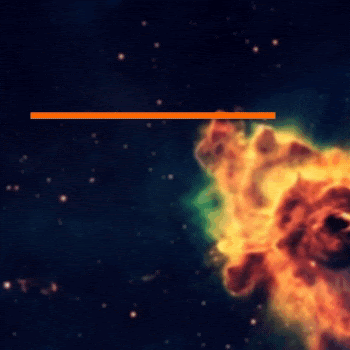-
Compteur de contenus
5138 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Trophée
15
Tout ce qui a été publié par Patrick FROMENT
-

Henri BROCH - Zététique - Art du doute - Science et paranormal
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Christian GIRARD dans Chemins de Traverse
Il me semble que deux choses soient confondues dans le propos : - Les "états de conscience" (veille, sommeil, rêve, coma...). et - Les "états mentaux conscients" (sensations, émotions, imagination, raisonnement...). Dans l'exemple de la gare que tu cites, on peut dire que toutes les personnes sont en état de conscience éveillée (si nous ajoutons un voyageur épuisé assoupi sur un banc, on peut dire que c'est, encore, un autre état de conscience). En revanche toutes les personnes que tu cites ont des états mentaux conscients différents. Quant à la question de savoir si un état de conscience est "normal" ou bien "modifié", ou "élargi" ou, encore, "altéré" c'est se placer en fonction d'une norme. La norme fixée comme point de référence étant, en général, l'état de veille qui permet les perceptions, le raisonnement, les sensations, l'imagination... (état pour lequel il est certainement possible d'avoir une infinité d'états mentaux). Concernant l'hypnose, nous pourrions dire (en nous plaçant dans une perspective non étatiste ) qu'il s'agit d'un état de veille caractérisé par des états mentaux conscients marqués par une forte suggestibilité. Ce compte rendu d'un colloque du collectif CARMEN me semble bien éclairer les choses : La conscience dans tous ses états Depuis 2018, le collectif CARMEN réunit des neuroscientifiques, des philosophes, des biologistes, des neurologues grenoblois qui s’intéressent aux questions autour de la conscience. -

Les Signes de l'Existence de la Réalité
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse
Oui ! De plus l'auteur a une approche transdisciplinaire comme je les aime : Les recherches d’Anil Seth misent sur la psychologie, la philosophie, l’informatique et l’intelligence artificielle, la physique et les mathématiques, et la psychiatrie et la neurologie pour cerner le fondement biologique de l’expérience consciente. source Pas mal d'éléments très intéressants, aussi, dans l'ouvrage, sur les "machines pensantes" et l'intelligence artificielle. -

Les Signes de l'Existence de la Réalité
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse
Anil Seth l’explique dés les premiers chapitres de son ouvrage : il raisonne dans un cadre strictement physicaliste (tout, y compris la conscience, se réduit in fine aux lois de la physique). L’auteur estime que ce cadre physicaliste est le plus fécond pour trouver une explication au mystère de la conscience. Cela ne l’empêche pas de tirer des conclusions plutôt étonnantes (ouvrirent que nous pourrions quasiment qualifié d’anti-réalistes ) : -
(Sans compter le cinquième: « Soyez sceptique, mais apprenez à écouter. » ) En effet, ces accords sont simples à comprendre (je tente d'appliquer à différents degrés et au quotidien ces « règles de bon sens » du développement personnel, ou du mieux-être en tout cas, et du respect de l'Autre). https://fr.wikipedia.org/wiki/Miguel_Ruiz J'avais fait une allusion à Patrick à ce propos, (ici : clic) qui lors d'un échange ne prenait pas me semblait-il assez de recul (relire les accords 2 et 3)... Attention les mecs ! Il y a quand même un gros souci avec ces deux ouvrages... C'est une imposture scientifique ! C'est pas moi qui le dit, c'est des gens raisonnables : Extrait de L'esprit critique pour les nuls par Thomas C. Durand (page 287) : Évitons, s'il vous plait, de faire la promotion d'impostures scientifiques sur VM. N'oublions pas que beaucoup de personnes fragiles et de mineurs, dont l'esprit critique n'est pas encore suffisamment développé, sont susceptibles de nous lire. Je vous rappelle les principes élémentaires de précaution : Dans le doute on suspend son jugement, on essaie de faire une évaluation correcte de la balance bénéfice-risque de ce genre de littérature de développement personnel largement teinté d'ésotérisme et on priorise correctement les hypothèses !
-

Les Signes de l'Existence de la Réalité
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse
Le best-seller du neuroscientifique Anil Seth (déjà évoqué par ici) est enfin traduit en français : Être soi - une nouvelle science de la conscience Extrait : Cela rappelle un peu la célèbre phrase de Paul Watzlawick : "Nous construisons le monde, alors que nous pensons le percevoir" Pour le chercheur Anil Seth, être conscient, c’est halluciner -

Henri BROCH - Zététique - Art du doute - Science et paranormal
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Christian GIRARD dans Chemins de Traverse
Oui psychanalyse... psychogénéalogie et tout le toutim... c'est même plus des cheveux qui hérissent là... -

Henri BROCH - Zététique - Art du doute - Science et paranormal
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Christian GIRARD dans Chemins de Traverse
C'est ce que je disais... L'astrologie, le tarot, les runes, le Yi King etc... sont comme des systèmes symboliques projectifs qui permettent d'envisager une situation sous d'autres angles et d'explorer des pistes auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Ce que tu fais c'est un peu du "tarot psychologique". Il existe tout un mouvement du tarot psychologique depuis bien longtemps. Un livre que ton bon cold reader devrait avoir lu : Interview de l'auteur ICI Ok... La référence à la notion de "synchronicité" et à la psychologie des profondeurs de Jung va faire s'hérisser quelques poils sur la tête de quelques rationalistes mais on peut aussi utiliser le tarot de manière complètement "laïque" comme tu sembles le faire. -

Henri BROCH - Zététique - Art du doute - Science et paranormal
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Christian GIRARD dans Chemins de Traverse
L'astrologie "marche" dans le sens où elle donne, en général, satisfaction à celui qui y croit et que ça va même constituer, pour cette personne, une aide et une ressource (Serge Bret-Morel explique ça dans son livre aux pages 180, 181 et suivantes). Donc, en ce sens, l'astrologie a une efficacité. Elle permet à un consultant de trouver un réconfort et même d'envisager sa situation sous un angle nouveau qu'il n'avait pas forcément exploré grâce à un symbolisme très riche (et au passage assez poétique), Bret-Morel parle de ça dans son livre, aussi, je crois. On peut tout à la fois dire cela et dire que les fondements théoriques et "scientifiques" de l'astrologie c'est du bullshit. Selon que l'on privilégie la vérité scientifique ou le réconfort que peuvent procurer certaines croyances ou pratiques, on va avoir une attitude un peu différente certes (l'ethnopsychiatre Tobie Nathan a écrit de très belles pages sur ce sujet il me semble). Peut être le tout est d'avoir ces deux enjeux présents à l'esprit et de pouvoir les concilier même s'ils semblent contradictoires. Une des choses que je reproche à la zététique est, souvent, de ne pas avoir cette vision globale et nuancée en considérant que l'astrologie (ou les arts divinatoires ou les méthodes de soin complémentaires comme l'ostéo dont tu parlais) c'est forcément nuisible parce que c'est fondé sur du bullshit, ça doit être dénoncé, démonté, debunké, réprimé voire éradiqué ... sans prendre en compte tout le côté bien être que ça peut apporter à certaines personnes. Je constate, néanmoins, que beaucoup de zététiciens de la nouvelle génération prennent en compte le fait que retirer une béquille à quelqu'un peut aussi avoir des conséquences fâcheuses. -

Henri BROCH - Zététique - Art du doute - Science et paranormal
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Christian GIRARD dans Chemins de Traverse
Oui alors que moi, dans ce cadre là, je voulais dire : qui a une efficacité thérapeutique (dans le cas de l'EMDR). Sur l'astrologie qui fonctionne, Serge Bret-Morel développe ça très bien (par exemple dans son ouvrage L'astrologie, ça marche !... Trop) En tout cas merci c'est beaucoup plus clair pour moi sur cette question du débat étatistes/non-étatistes. J'ai trouvé ça, aussi, qui me semble assez bien résumer les choses : Etat / Non-étatiques (The State - Nonstate Debate) Ok je parlais, moi, de l'expression "dérapeute" qui était souvent utilisé par Guy Rouquet le président de l'association Psychothérapie Vigilance. -

Henri BROCH - Zététique - Art du doute - Science et paranormal
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Christian GIRARD dans Chemins de Traverse
Très instructif ces derniers messages. On retombe sur des idées déjà développées ici : Première idée : Certaines choses "fonctionnent" mais peut être pas pour les raisons qu’on pense qu’elles fonctionnent. L’astrologie "fonctionne" mais pas pour les raisons qu’on pense, idem pour l’EMDR. Du coup on retrouve le clivage dont je parlais : celui du praticien-clinicien qui s’attache à ce qui "fonctionne" au risque de prendre quelques libertés avec l’idée de "vérité" et celui du chercheur (voire du chercheur sceptique-rationaliste) qui cherche une vérité objective. Deuxième idée : l’importance du fameux paradigme et, non seulement, du paradigme mais aussi de tous les présupposés et du cadre conceptuel qu’on se fixe (à cet égard le scepticisme scientifique n’est pas qu’une méthode, c’est aussi un cadre et ce cadre influe forcément sur l'observation de celui qui choisit d'adopter ce cadre). Par ailleurs, difficile de parler du TDI et des personnalités multiples, par exemple, sans avoir une théorie de la personnalité, or des théories de la personnalité, il y en a plusieurs en psychologie et des antagonistes. La théorie de la personnalité va forcément influer sur la pratique. Je te sens, Pierre-André, dans une approche plutôt cognitivo-comportementale (c’est pas une critique hein ! ). Non.. tu reprends la rhétorique ancienne de l'association Psychothérapie Vigilance. -

Henri BROCH - Zététique - Art du doute - Science et paranormal
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Christian GIRARD dans Chemins de Traverse
Merci @Pierre-André GOSSELIN Très intéressant ! ça peut répondre partiellement à la question posée souvent par des sceptiques (et posée hier par Clément je crois) sur le mode "état de conscience modifié.. ok... mais qu'est qu'un état de conscience 'ordinaire' ". Pour la question des transes, il y a l'article wikipédia ICI qui vaut ce qu'il vaut (très succinct) mais quand même avec une liste assez intéressante des différentes formes de transes. La transe de personnalités multiples (trouble dissociatif de l'identité) est citée, je vois que l'état de rêve est classé dans les transes aussi (mais bon je ne sais pas ce que vaut cette liste sur le plan scientifique)... il y aussi la "transe érotique" qui est citée et l'orgasme ! -

Henri BROCH - Zététique - Art du doute - Science et paranormal
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Christian GIRARD dans Chemins de Traverse
Il y a un biais aussi à vouloir explorer principalement les hypothèses psychologiques conventionnelles. Là encore, il y a biais à s'intéresser à comprendre le phénomène (sous-entendu, j'imagine, dans un cadre théorique, rationnel et naturaliste) sans prendre en compte la "clinique". J'utilise le mot "clinique" à dessein. Le terme de "clinique" désigne étymologiquement l'activité "au lit du patient". Il s'agit d'un acte se fondant sur une rencontre entre deux individus à visée d'évaluation ou d'accompagnement. C'est le sens que ce mot prend dans l'expression "psychologie clinique". Bien sûr, il ne s'agit pas, forcément, d'opposer les deux approches (même si tu le fais un peu dans la deuxième citation ) mais il est vrai que l'approche clinique demande souvent de mettre de côté la compréhension théorique (ou, en tout cas, de la laisser en arrière plan). Les psychologues du courant humaniste et existentiel considèrent, souvent, qu'il faut sans arrêt réinventer la théorie en fonction de chaque situation clinique et je suis assez d'accord avec ça. C'est peut être pour ça que Thomas Rabeyron parle de "Clinique des expériences exceptionnelles" plutôt que de "psychologie anomalistique" (même s'il s'y réfère aussi). Cette citation de Laurence John Bendit, un psychiatre qui s'intéressait au paranormal (et un peu théosophe sur les bords aussi) montre bien, aussi, la nuance : "On se doit d’accueillir le matériel proposé par le patient, tel qu’il est présenté, l’analyser et tenter de le comprendre, mais sans essayer de le corroborer par des vérifications extérieures comme on le ferait pour établir un fait." Il est vrai que de par ma sensibilité, mon expérience de vie, mon parcours, mon métier, je suis plus intéressé à accompagner et à m'intéresser à la vérité d'un vécu subjectif unique et irréductible plutôt qu'à essayer de dégager une vérité qui se veut objective et à valeur universelle. Ce qui explique aussi mon attitude face à une discipline comme la zététique ... même si, bien sûr, ça m'intéresse aussi de comprendre les phénomènes mais les deux approches et démarches sont différentes (tout en étant aussi utiles l'une que l'autre). -

Henri BROCH - Zététique - Art du doute - Science et paranormal
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Christian GIRARD dans Chemins de Traverse
Ok... Bon... Je ne suis pas un spécialiste de l'hypnose et je sais qu'il y a depuis les origines une difficulté à définir et à qualifier ce qu'est l'hypnose. Je vois la controverse sur la notion de "état" ou "état de conscience". Il faudrait, peut être, définir ce qu'est un "état". Est ce que nous sommes d'accord pour dire que la veille, le sommeil profond et le rêve sont trois "états" de conscience différents ? Si c'est le cas on n'a pas trop besoin des neurosciences pour qualifier ces "états" la philosophie védantique les avait déjà repéré il y a plus de 2500 ans. Mais, ok, parlons neurosciences néanmoins... Pour les "étatistes" comme les nomment Clément, il semble que ce soit les ondes cérébrales qui permettent de catégoriser un état de conscience d'un autre. Et on trouve souvent des référence comme ce genre de tableau : ... Bullshit ou pas ? Si j'ai bien compris ce qui a été dit plus haut et si je devance un peu la réponse de Clément, il ne faut pas confondre "activité cérébrale" et "état". Les ondes cérébrales catégorisent une "activité cérébrale" pas un "état". Du coup on tourne un peu en rond : Les étatistes disent que les ondes cérébrales catégorisent un état. Les autres soutiennent que les ondes cérébrales sont simplement un signe d'une certaine activité cérébrale. Et les premiers rétorquent que c'est justement l'activité cérébrale (les ondes émises) qui permettent de catégoriser un état. Est-ce qu'on n'est pas dans une guerre de mots ? C'est quoi un "état" ? -

Henri BROCH - Zététique - Art du doute - Science et paranormal
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Christian GIRARD dans Chemins de Traverse
Merci les amis ! Si vous avez le même genre de matériel sur l'EMDR je suis preneur. J'ai eu une grosse discussion avec une collègue psychologue clinicienne il y a quelques semaines qui me soutenait l'efficacité de l'EMDR (alors que plusieurs études montrent que ça marche aussi sans les mouvements oculaires). Ce qui voudrait dire que l'EMDR est efficace non pas en raison des mouvements oculaires mais du fait de tout l'emballage autour qui est commun aux psychothérapies (écoute bienveillante, anamnèse, empathie du thérapeute, techniques d'exposition au trauma (pour les cas de stress p o s t traumatique) etc...). -

Henri BROCH - Zététique - Art du doute - Science et paranormal
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Christian GIRARD dans Chemins de Traverse
Oh my god ! Si on ouvre un débat sur l'hypnose avant Noël ! Merci ! Le genre de lien que j'affectionne ! -

Henri BROCH - Zététique - Art du doute - Science et paranormal
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Christian GIRARD dans Chemins de Traverse
Je voulais dire que, pour un effet mesurable physiquement, il est relativement facile de mettre en place un protocole avec tous les gardes fous nécessaires. Concernant des expériences purement subjectives qui se passent dans l’esprit du sujet, la question est très différente et c’est un peu plus coton (même pour un spécialiste). Quel est, par exemple, le statut épistémologique d’un vécu subjectif de communication avec les défunts ou d’une transe chamanique ? En général, un sceptique préfèrera considérer ces témoignages comme des affabulations invérifiables ou privilégiera l’explication psychopathologique. -

Les Signes de l'Existence de Dieu
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Boumedienne HAMBLI dans Chemins de Traverse
J'ai eu longtemps, aussi, cette croyance que, du fait que le monothéisme était une religion révélée qui mettait l'homme au centre de la création, le monothéisme favorisait donc une forme d'intolérance. Je n'en suis plus aussi sûr. Est-ce que les polythéismes et les religion non révélées favorisent une plus grande tolérance ? C'est possible mais c'est discutable. Je crois qu'on ne peut pas vraiment généraliser et que ça dépend essentiellement de comment on vit et pratique sa foi. Il semble que le nationalisme hindou fasse des ravages en Inde : L'inquiétante montée de l'intolérance en Inde Là aussi, il me semble qu'il faut se garder de généraliser. L'hindouisme est devenu un sujet très politique en Inde (c'est peut être ça le problème !... quand la religion devient un sujet politique (ou la politique un sujet religieux)). Par ailleurs, l'hindouisme est tantôt classé dans les monothéismes ou dans les polythéismes selon les spécialistes des religions. -

Henri BROCH - Zététique - Art du doute - Science et paranormal
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Christian GIRARD dans Chemins de Traverse
Cela me semble même très équilibré et très raisonnable comme position ! Oui, il y a ça qui est sorti il y pas longtemps. C'est un véritable pavé (700 pages 1,2 kilos ) : C'est plutôt une approche psy, je n'ai fait que le feuilleter en librairie. En tout cas ça m'a l'air très complet et très sérieux. -

Henri BROCH - Zététique - Art du doute - Science et paranormal
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Christian GIRARD dans Chemins de Traverse
Oui j'ai lu ! Très bon livre comme les autres de cet auteur autour du développement personnel ou même son ouvrage moins connu sur le thème du polyamour. Beaucoup de très bonnes remarques dans ton dernier message. cela fait un moment que j'ai envie de te voir en spectacle, j'espère que ce pourra être le cas dans l'année à venir, par exemple à la faveur d'un de mes passages sur Paris. -

Henri BROCH - Zététique - Art du doute - Science et paranormal
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Christian GIRARD dans Chemins de Traverse
Oui ! En tout cas, ça devrait être cela ! Pas de souci j'aime bien les provocateurs ! Ça, ça reste encore des problèmes simples (je veux dire les lois physiques qui permettent de faire voler des avions sont, aujourd'hui, parfaitement connues et maitrisées). En sciences humaines, on ne peut pas appliquer le principe de parcimonie de la même manière qu'on l'applique dans les sciences physiques. "Les explications les plus simples ne sont pas toujours vraies dans notre monde aussi prodigieusement complexe" - Stephen Jay Gould Même sur la question du paranormal, il y a différents niveaux de complexités et tu le sais très bien. Savoir si Uri Geller tord le métal a l'aide de télékinésie ou de méthodes d'illusionniste est une question assez simple. Se positionner sur certaines expériences exceptionnelles plus "subtiles" comme un ressenti de télépathie, un cas de glossolalie ou une VSCD (vécu subjectif de communication avec les défunts) peut être un peu plus complexe. Voir à ce sujet le travail de psychologues comme Thomas Rabeyron, Renaud Evrard ou, plus loin de nous, Théodore Flournoy et tout le mouvement de la psychologie anomalistique. -

Henri BROCH - Zététique - Art du doute - Science et paranormal
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Christian GIRARD dans Chemins de Traverse
@Thierry SCHERER (Zarcanum) Si j'ai bien compris tu te réclames d'une forme de relativisme (au sens philosophique) tout en ayant pour "outil principal" de ta pensée, la zététique. Mais j'adoooooooreeeee !!! Il faudra qu'on en cause à l'occasion lors d'un appel téléphonique ! Je ne plaisante pas : tu sais que j'adore les personnes qui osent concilier les contraires ! Car : qu'est ce qui semble plus éloigné de la zététique que le relativisme au sens du relativisme épistémologique de philosophes des sciences comme Paul Feyerabend ou Thomas Khun (si Kuhn a nié être relativiste, sa pensée a néanmoins jeté les bases de ce qui est devenu le relativisme scientifique).. Deux extraits d'un article intéressant sur le relativisme épistémologique (même si l'article concerne le droit - source) : On retrouve l'idée développée plus haut par Aurélien Barrau : Le relativisme ce n'est pas mettre en cause la notion de vérité, c'est questionner, aussi, le cadre de référence qui rend une proposition vrai ou fausse ! -
Au delà de la problématique du spectateur croyant, il semble que, dans ce cas, la difficulté était qu'ils n'étaient, tout simplement, pas intéressés par ce que tu proposais. Était-ce, comme tu le dis, parce que, pour eux, la question de la véracité de la télépathie était une question réglée et, que donc, ta démonstration n'apportait aucun intérêt et élément de plus ? ... Peut-être, aussi, que tu n'as pas su les intéresser ou que ta démonstration n'était pas "divertissante". Quoi qu'il en soit, il me semble difficile d’intéresser au mentalisme (ou la magie) un public qui ne s'y intéresse pas. Peut-être aussi (mais c'est encore une hypothèse) tu étais trop dans la démonstration et tu ne les as pas assez impliqués. J'ai remarqué, parfois, que, chez un public croyant, la démonstration de capacités paranormales n'est pas très impressionnante, par contre leur montrer qu'ils ont, eux mêmes, ce genre de capacité est beaucoup plus impressionnant.
-

Henri BROCH - Zététique - Art du doute - Science et paranormal
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Christian GIRARD dans Chemins de Traverse
C'est une très bonne définition du relativisme (un terme hélas devenu trop souvent péjoratif). J'avais déjà donné, par ailleurs, l'excellente définition du relativisme d'Aurélien Barrau : Je me demande même si "relativisme" ne serait pas l'exact contraire de "zététique" Si tu te nourris de zététique (et que de zététique) sans philosophie, sans spiritualité, sans poésie, sans merveilleux j'ai peur que ça tourne vite en rond ! -

Les Signes de l'Existence de Dieu
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Boumedienne HAMBLI dans Chemins de Traverse
Je suis d'accord... Oui et non ! Ta remarque autour de l'ego est pertinente et j'avais, d'ailleurs, envie de venir sur cette question de l'ego concernant les causes des conflits. Par contre je ne suis pas d'accord quand tu dis que l'ego (ou l'idéologie égocentrée) est "induit" par les religions monothéistes. L'ego fait partie du fonctionnement "normal" de l'être humain. L'ego, en gros, c'est cette attitude qui considère que ma petite personne existe indépendamment du monde et du reste de l'humanité et qu'il y a une sorte de "maitre à bord" à l'intérieur de moi même qui est chargé de défendre mes intérêts contre le reste du monde. L'ego est certainement nécessaire pour vivre, survire et s'affirmer mais quand il est démesuré ça pose problème (et l'ego a tendance a devenir très vite démesuré ). Du coup, avec l'ego et l'egocentrisme, on retrouve mon hypothèse selon laquelle le conflit et la guerre font partie intrinsèquement de la nature humaine (d'une partie de la nature humaine en tout cas). Comme la religion peut être un élément d'identité très fort, elle peut venir exacerber l'ego mais je ne pense pas que c'est la religion qui "induit" l'ego (même dans sa version monothéiste). -

Les Signes de l'Existence de Dieu
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Boumedienne HAMBLI dans Chemins de Traverse
Là aussi, à moins de m'être mal exprimé je ne pense pas avoir dit que la religion n'est jamais source de conflit. Même si j'ai tendance à penser que la religion est plus un prétexte. Le conflit prend une forme (une coloration) religieuse mais la (ou les) causes profondes du conflit sont souvent plus complexes. Je vois que Denis Crouzet (un historien) s'interroge sur la part du religieux et du politique dans les guerres de religion : Quelle fut, dans les guerres de religion, la part du religieux et du politique ? Il faut bien voir que politique et religion ont été étroitement liées jusqu'à la sécularisation de nos sociétés. Depuis que l'empereur Constantin 1er se convertit au christianisme (semble-t-il dans un calcul politique d'unifier l'Empire) et jusqu'au 18e/19e siècle a religion se sert de la politique et la politique se sert de la religion. Il faudrait demander leur avis aux rohingyas en Birmanie ou aux quelques chrétiens du Bhoutan... Birmanie : quand le bouddhisme prêche la haine BHOUTAN. Bouddhisme et tolérance ne font pas bon ménage
-
Qui est en ligne (en orange les membres du Cercle VM) - 0 membre, 0 anonyme, 63 invités Afficher la liste
- Aucun utilisateur enregistré actuellement en ligne