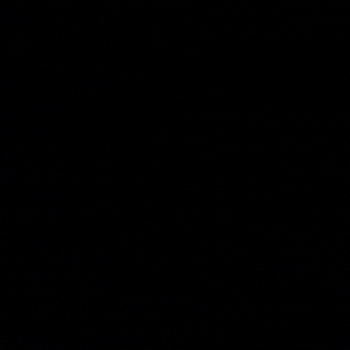-
Compteur de contenus
5138 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Trophée
15
Tout ce qui a été publié par Patrick FROMENT
-

Les Signes de l'Existence de la Réalité
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse
Tu as raison de signaler qu’il y a plein d’autres mystères. Le statut particulier parfois attribué au mystère de la conscience tient peut-être au fait qu’un mystère est toujours construit dans une conscience (ou un esprit si tu préfères). C’est la conscience qui appréhende les choses par le biais des sens. C’est la conscience qui se pose des questions sur ce qu’elle appréhende. C’est aussi la conscience qui arrive à résoudre les anciens mystères par le biais de la rationalité, de la logique ou de l’approche empirique (qui, au passage, sont autant d’inventions de… la conscience). C’est, encore et toujours, la conscience qui constate que tel mystère résiste à l’entendement. Et, enfin, c’est aussi une conscience purement subjective qui décide que ce mystère est fondamental ou qui choisit au contraire de le relativiser. Cette sacralisation ou cette relativisation du mystère de la conscience se fait sur la base d’arguments qui restent toujours subjectifs et discutables. -

Les Signes de l'Existence de la Réalité
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse
Ce fossé explicatif là pose quand même de sacrées questions sur la nature même des choses. J’en vois au moins deux de taille : Entre un objet physique (par exemple une table) et un objet mental (par exemple une pensée), il semble que nous soyons face à deux catégories d’objets de natures fondamentalement différentes, d’où l’idée très ancienne du dualisme entre le physique et le mental. L’autre question qui est restée à peu près intacte depuis Descartes est comment l’un interagit avec l’autre. La question s’est même complexifiée depuis Descartes si nous rejetons le dualisme et si nous adoptons la perspective du monisme physicaliste (très populaire dans les sciences sous nos latitudes). Pour le dire avec les mots précis de Joseph Levine : il nous manque une explication du mental dans les termes du physique. -

Les Signes de l'Existence de la Réalité
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse
Peut être ! Il reste juste à résoudre le fossé explicatif ! -

Les Signes de l'Existence de la Réalité
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse
Les questions les plus fondamentales (et aujourd'hui sans réponse) résumées avec brio en moins d'une minute : -

Les Signes de l'Existence de la Réalité
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse
C'est une bonne question ça ! Enfin... Tu es un farceur car si la chose "n'existe pas" il n'y a rien sur quoi baser sa "probabilité" ! Nous pouvons néanmoins spéculer sur l'existence potentielle d'une chose ou d'un évènement. Il y a les approches bayésiennes (chères à certains sceptiques (même si beaucoup n'y comprennent rien)) : Dans le même style il y a l'équation de Drake aussi qui tente d'estimer le nombre potentiel de civilisations extraterrestres dans notre galaxie avec qui nous pourrions entrer en contact : N=R*xFPxFExNExFIxFCxL. Les différents termes de l'équation sont les suivants : R* = Le taux de formation dans la Voie lactée des étoiles adaptées au développement de la vie intelligente. Fp = La fraction de ces étoiles avec des systèmes planétaires. Ne = Le nombre des exoplanètes, pour chaque système planétaire, avec un environnement propice à la vie. Fl = La fraction des exoplanètes habitables sur lesquelles la vie apparaît réellement. Fi = La fraction de ces planètes permettant l'apparition de la vie intelligente civilisée. Fc = La fraction de ces civilisations qui développent une technologie dont on peut repérer la signature, notamment parce qu'elles cherchent à communiquer avec d'autres civilisations comparables. L = La durée pendant laquelle de telles civilisations possèdent des technosignatures détectables. ça aussi c'est une put*in de bonne question ! Et... une sacrée expérience de pensée ! Ta réponse suggère que nous sommes notre cerveau : C'est aussi la thèse de neuroscientifiques tels que Stanislas Dehaene : Nous sommes notre cerveau (l'article n'est pas consultable entièrement pour les non abonnés) Ce long article par contre est entièrement lisible et très intéressant : Greffe de tête : de l’héritage philosophique aux problématiques bioéthiques J'avais déjà signalé, aussi, ce petit ouvrage d'une neuroscientifique chrétienne (mais très intéressant sur le plan scientifique et philosophique si on met de côté les considérations plus théologiques) : -
Il s'agit d'un book test en anglais sous la forme d'une luxueuse édition du Chien des Baskervilles d'Arthur Conan Doyle. La méthodologie est très atypique. Je n'ai jamais vu rien de semblable sur aucun book test. Etat neuf 90 euros les frais de port compris (pour la France)
-
Je me sépare de ce book test. Il s’agit d’un article de collection exceptionnel, un livre vieilli à la main présentant l’aspect d’une authentique édition ancienne. Dans la légendaire collection des Dopplegänger de Prof BC, le livre d’Alice permettant de révéler non seulement des mots mais de nombreux détails sur les dessins. Chaque ouvrage de la collection des Dopplegänger a été produit à 100 exemplaires uniquement, ils sont aujourd'hui à peu près introuvables. Le livre Alice au pays des merveilles + le certificat d’authenticité + le pdf d’explications (271 pages !) Tout est en anglais bien sûr. 260 euros les frais de port compris (pour la France) me semble un prix très correct (j'ai vu des exemplaires de Dopplegänger se négocier le double) Pour ceux qui souhaitent en savoir plus un fil de VM est consacré aux Dopplegänger de Prof BC :
-

Les Signes de l'Existence de la Réalité
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse
Je recite la citation de Mickaël issue de la citation de Christian issue de la citation de numerama (wouah la mise en abîme ! ). Numerama enfonce un peu une porte ouverte sur ce coup là : Il n'y a pas que sur wikipédia que les articles historiques sont plus susceptibles de faire ressurgir une idéologie que des articles scientifiques. L'Histoire n'est pas qu'un recensement d'évènements factuels, c'est aussi un récit, une mise en perspective. L'interprétation et l'idéologie s'y glissent donc plus facilement que dans la science. -

Les Signes de l'Existence de la Réalité
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse
Tu es bien sévère Étienne ! Au delà des théories invérifiables, il y a dans ce petit topo de GPT4, des idées et des arguments plutôt intéressants et qui ont d'ailleurs déjà été discutés par ici. Par exemple le trouble dissociatif de l'identité (que GPT nomme improprement "phénomène de la double conscience" dans le point 7). Le point 11 sur la neuroplasticité (la conscience modifie la structure du cerveau) suggérant que la relation entre la conscience et l'activité neuronale est plus complexe qu'un simple lien de cause à effet. Le point 12 est, lui aussi, fondamental et mérite d'être rappelé avec force même si cela a déjà été discuté maintes fois ici (et ailleurs) : La question de savoir comment l'activité neuronale produit des expériences subjectives reste sans réponse. Tout ça ne prouve rien quant à la possibilité d'une conscience extra-neuronale mais montre bien la complexité du débat et la difficulté à maintenir la question de la conscience dans un cadre strictement physicaliste et naturaliste. Oui ! Et cette question pas simple a, elle aussi, déjà été abordée par ici. On peut dire, d'ailleurs, que ChatGPT produit des "signes de conscience" assez ahurissants : - la maîtrise du langage - la capacité à interagir avec autrui et à dialoguer - une intelligence et une culture générale se situant dans la moyenne très haute de la population Et pourtant il n'est pas conscient, il n'est qu'une sorte de robot très sophistiqué. A l'inverse si nous nous plaçons dans la perspective (aujourd'hui invérifiable) du panpsychisme, on considère que l'atome a déjà une forme de conscience (un sentiment de ce que ça fait d'être un atome) ...sans le langage, sans l'intelligence et sans la capacité à produire des signes intelligibles par autrui. Par certains aspects cette question me rappelle le paradoxe de Fermi. La réponse au paradoxe de Fermi est d'ailleurs souvent argumentée par l’impossibilité physique qu'une intelligence extra-terrestre aurait de se manifester à nous (distances colossales, impossibilité technologique etc...). Parfois aussi la raison éthiques est invoquée : Va savoir... le même problème se pose peut être avec une "conscience décorrélée de l'activité cérébrale" qui serait, par nature, plus "sage" (n'étant plus soumise aux contingences de la matière ). On peut donc utiliser les mêmes arguments du paradoxe de Fermi pour expliquer qu'une conscience extra-neuronale ne se manifeste pas à nous. Mais... il est vrai que l'hypothèse d'une vie extra-terrestre se conjugue mieux avec une perspective naturaliste et physicaliste que celle d'une conscience extra-neuronale qui vient, au contraire, contredire le paradigme physicaliste. On en revient à la question du scepticisme sélectif évoquée dans un autre fil. -

Les Signes de l'Existence de la Réalité
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse
Pour rappeler quelques évidences : On ne peut pas "voir" ou "toucher" la conscience (on a déjà beaucoup de mal à la définir)… On ne fait jamais qu’éprouver sa propre conscience. Nous supposons qu’autrui possède une conscience similaire à la notre (nous en sommes même certains) mais nous ne faisons qu’interpréter des signes (voir la théorie des zombies philosophiques de David Chalmers). Par ailleurs même en observant le cerveau on ne rencontre jamais LA conscience, on ne fait que constater des évènements cérébraux qu’on corrèle à des évènements mentaux. Pourvoir produire des "preuves" de la conscience repose finalement sur la capacité du sujet à produire des signes de conscience (et donc, essentiellement, à émettre des signes physiques avec son corps). La question de Christian devrait donc être complétée, par exemple ainsi : on attend toujours ne serait-ce qu’un seul exemple de conscience décorrélée d’une activité neuronale capable de produire des signes sur le plan physique (cette formulation précise bien la question... tout en en l'enfermant dans le cadre strict du naturalisme. Ce qui peut être considéré comme une contradiction puisque l'expression "conscience décorrélée d’une activité neuronale" porte en elle-même une certaine idée de transcendance, transcendance qui est immédiatement exclue par le cadre même de la question ). Par ailleurs, le syndrome d’enfermement nous permet aussi d’envisager cette question de la conscience d’autrui et des signes de la conscience d’autrui sous d’autres angles. -
Cause double emploi, je vends ce livre en état neuf. 48 euros fdpi inclus (pour la France) Paypal possible
-
État neuf et impeccable. Complet avec les cartes. 55 Euros fdpi inclus (pour la France) Paypal possible
-

Les Signes de l'Existence de la Réalité
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse
J'aurais pu publier cette vidéo dans le fil sur les EMI mais il me semble judicieux de la mettre ici vu que le thème sous-jacent de cette causerie est la conscience. Sylvie Dethiollaz est Docteure ès sciences, Docteure en biologie moléculaire. Plein d'idées discutées tout au long des pages de ce fil sont présentes dans le propos de Sylvie Dethiollaz : 11:30 "La conscience n’est pas une production de l’activité cérébrale." 11:55 "La conscience n’est pas produite par le cerveau mais appartient à une dimension qui est au delà de l’espace-temps." 12:20 "La conscience est le substrat même, l’essence de l’univers, de tout ce qui existe." 12:50 "C’est un renversement de perspective par rapport à l’idée que c’est la matière qui a donné naissance à la conscience." (le fameux retournement de la chaussette ! ) 13:35 "Le cerveau est un récepteur mais une fois que le récepteur s’éteint, la conscience n’est plus liée à ce récepteur mais continue d’exister au delà." On pourra soutenir, bien entendu, que toutes ces affirmations sont péremptoires et ne sont jamais étayées par Sylvie Dethiollaz autrement que par l'argument des EMI qui vaut ce qu'il vaut et qui est très controversé. Certes ! Mais... Dire que... "La conscience est le produit de l'activité cérébrale." .. est tout aussi péremptoire et impossible à prouver. Pour les arguments je renvoie le lecteur vers nombreuses pages de débat dans ce fil autour de ce sujet. Si on veut résumer les arguments à l'extrême : -
Je suis allé voir "Crois en tes rêves" au théâtre Déjazet en novembre dernier et j'avoue que je me suis laissé embarquer dans l'histoire du jeune enfant de banlieue passionné de magie jusqu'au flying final. Très belle mise en scène avec les vidéos qui racontent la vie de Kamel (la méga prédiction qui utilise la vidéo est d'ailleurs assez époustouflante).
-

Henri BROCH - Zététique - Art du doute - Science et paranormal
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Christian GIRARD dans Chemins de Traverse
Si j’étais farceur, je dirais aussi : Un dieu créateur de l’univers... Non ! Par contre… une fluctuation quantique du vide, Oui ! -

Henri BROCH - Zététique - Art du doute - Science et paranormal
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Christian GIRARD dans Chemins de Traverse
Effectivement ! J'ai souvent remarqué ce type de "scepticisme sélectif" chez nos spectateurs confrontés à une expérience de mentalisme (y compris les plus sceptiques). la voyance et la mediumnité... Non ! Par contre la télépathie, Oui ! ou alors : la télépathie... Non ! Par contre la psychologie et les neurones miroirs, Oui ! ou bien : le mythe de l'Atlantide... Non ! Par contre les soucoupes volantes et les extra-terrestres qui visitent notre Terre, Oui ! Je pourrais multiplier les exemples. En fait il y a toujours une faille (même chez les plus sceptiques des sceptiques ). Et il est intéressant, parfois, en discutant avec un spectateur de trouver son domaine de prédilection et de mettre nos présentations en lien. -

Henri BROCH - Zététique - Art du doute - Science et paranormal
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Christian GIRARD dans Chemins de Traverse
Le psychologue et maître de conférences Renaud Evrard en donne une très bonne démonstration dans son dernier livre : Phénomènes Inexpliqués Cela faisait longtemps que je n’avais pas lu quelque chose d’aussi intelligent sur ce thème. Je vois recommande aussi le chapitre 4 nommé : L’opposition factice de la zététique. Petit passage marrant sur ce que l’auteur appelle le jeu des quatre familles sceptiques (après quel type d’athée êtes-vous ?, quel type de zététicien êtes vous ? ) : -

Henri BROCH - Zététique - Art du doute - Science et paranormal
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Christian GIRARD dans Chemins de Traverse
Oui... L'auteur de l'article que j'ai mis en lien parle plusieurs fois de ce qu'il appelle le "simplisme" de la zététique. Nous avons évoqué, plusieurs fois dans ce fil, le fait que la zététique est efficace pour s'attaquer à des problèmes simples. Débusquer une fraude ou un biais cognitif dans un phénomène prétendument paranormal est un problème relativement simple... quand on a les bons outils !... Ce qui ne veut pas dire, par ailleurs, que la question du paranormal est un problème simple quand on s'y attaque d'une manière plus globale. Cette question est pluri-disciplinaire et requiert, non seulement, une expertise dans le domaine des biais cognitifs mais aussi en épistémologie, psychologie, philosophie, anthropologie et j'en passe. Pour citer un autre extrait de l'article en question : Avoir des victoires trop faciles comme c'est le cas de la zététique "historique", ou bien, étendre le champ de la méthode scientifique à tout et n'importe quoi comme c'est le cas de la zététique "nouvelle tendance" au risque de produire une aberration épistémologique, tel est le dilemme de la zététique ! Il y a d’ailleurs ça qui vient de paraître : 50 ans de Zététique, livre entretien entre Henri Broch et Richard Monvoisin : Deux zététiciens historiques (le fondateur et son élève) qui semblent prendre du recul et de la distance par rapport à la nébuleuse : -

Henri BROCH - Zététique - Art du doute - Science et paranormal
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Christian GIRARD dans Chemins de Traverse
La revue European Scientist publie sur son site une critique de la zététique aux arguments très rationnels : Zététique, Fact-checkers, Debunkers : la régression de l’esprit critique L'article commence par quelques rudiments d'épistémologie autour de la question épineuse du critère de scientificité. Kant et Popper sont, bien sûr, convoqués. L'article montre comment le critère de scientificité peut, aussi, se retourner contre les fact-checkers et les zététiciens (j'ai déjà dû épiloguer, par ici, sur ce thème il me semble). Cette partie se termine sur une considération particulièrement pertinente : Sur "la" méthode scientifique : Sur la prétention de la zététique : Sur certaines implications philosophico-politiques de la zététique : De la belle ouvrage ! -

"Psychic Reading" en français
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Romain P!R3S dans Forum Général
Il y a le même problème avec "psychic entertainer" qui est à peu près intraduisible en français. Il est possible, aussi, que ces termes traduisent une plus grande porosité dans la culture anglo saxonne entre le monde du paranormal et celui du divertissement. -

L’Illusionnisme ne sert-il qu’à Divertir ?
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Forum Général
Merci @Christian DELAMORINIERE Au vu de la synthèse de GPT, je me dis que nous avons bien traité le sujet depuis 2013 avec la cinquantaine de pages (ou alors c'est GPT qui a bien pompé le sujet ! ). -

L’Illusionnisme ne sert-il qu’à Divertir ?
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Forum Général
L'illusionnisme ne sert-il qu'à divertir ? .... J'ai posé la question à chatGPT (c'est le dernier truc à la mode pour avoir des arguments d'autorité ! ) : L'illusionnisme est souvent utilisé pour divertir les gens et leur offrir un spectacle impressionnant et fascinant. Cependant, l'illusionnisme peut aussi avoir d'autres utilisations et significations. Par exemple, l'illusionnisme peut être utilisé comme une forme d'art pour exprimer des idées et des émotions complexes. Les illusionnistes peuvent utiliser des tours pour explorer des thèmes comme la perception, la réalité, la confiance, et la tromperie. De plus, l'illusionnisme peut être utilisé pour la psychologie et la thérapie. Les thérapeutes peuvent utiliser des illusions pour aider les gens à surmonter des phobies ou des troubles anxieux. Les psychologues peuvent également utiliser des illusions pour étudier la perception et la cognition. Enfin, l'illusionnisme peut également être utilisé pour la communication et l'enseignement. Les illusionnistes peuvent utiliser des tours pour illustrer des concepts scientifiques ou mathématiques complexes, ou pour captiver l'attention des élèves et des audiences lors de présentations ou de discours. En résumé, bien que l'illusionnisme soit souvent associé à la simple diversion, il peut avoir de nombreuses autres utilisations et significations, notamment comme une forme d'art, pour la psychologie et la thérapie, ainsi que pour la communication et l'enseignement. GPT3 -

Les Signes de l'Existence de la Réalité
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse
Sébastien Thill dans Labyrinthe ... Je n'ai pas vu le spectacle mais il semble bien qu'il surfe sur la question fondamentale de la philosophie : -

"Psychic Reading" en français
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Romain P!R3S dans Forum Général
J’imagine qu’il faut lire : « C'est finalement en m'éloignant le plus de la magie que j'ai l'impression de me rapprocher le plus de la Magie. » (avec la nuance subtile magie et Magie ) Pour avoir emprunter ce chemin moi même, je me sens complètement en accord avec ta vision. J'imagine que tu connais le travail de Enrique Enriquez. Ce débat surréaliste était certainement nécessaire pour faire comprendre certaines choses. On retrouve les mêmes divergences (ou convergences, ça dépend de quel point de vue on se place) dans le domaine de la mémoire. Je lisais d’ailleurs su ce forum la très bonne réflexion suivante : … et, bien sûr, nous retrouvons ça aussi dans le domaine de l’hypnose (hypnose de spectacle / hypnose thérapeutique). Pour revenir à ta question : « Psychic reading » est une expression qui a un sens dans la culture anglo-saxonne, il est d’ailleurs intéressant de voir ce que ça recouvre : Psychic reading « Arts divinatoires » serait peut être l’expression qui s’en rapproche le plus en français. Je comprends que cette expression n’est pas complètement satisfaisante pour toutes les raisons que tu évoques. Peut être le plus simple est d’utiliser des mots qui parlent à l’imaginaire des spectateurs et qui s’adaptent à tes présentations. Pour ma part, j’aime bien proposer une expérience de quelque chose… On a le choix une expérience de télépathie, une expérience de psychologie, une expérience d’influence…. Pour un reading pur, c'est à dire une expérience où tu parles de la personnalité du spectateur et où tu révèles des informations sur son présent, son passé et son avenir peut être le plus sage est de ne pas nommer ce que tu fais et laisser le spectateur interpréter librement. Je crois qu'elle est un peu endormie . Il y a quelques années un message comme le tien aurait déjà suscité bien des polémiques. -

Les Signes de l'Existence de la Réalité
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse
Ces considérations intéressantes sur les couleurs renvoient à la notion de qualités premières et secondaires : Cette dichotomie ne présente pas d'ailleurs que des avantages... ... Et elle est aussi sujette à discussion : Qu'est ce qui est "primaire" et qu'est ce qui est "secondaire" ? C'est tout le débat entre l'objectif et le subjectif, débat bien plus épineux qu'il n'y parait de prime abord car on peut considérer, aussi, que c'est l'intersubjectivité qui définit l'objectivité et que, donc, le concept d'"objectivité" émerge au cœur de la subjectivité (ça aussi ça a été abordé par ici). Intersubjectivité Sur ce thème c'est, encore une fois, Berkeley qui a le dernier mot (mais bon... ça reste une appréciation subjective ! ) :
- Pas de pub non magique pour les membres du Cercle VM. Clique ici pour en savoir plus !
-
Qui est en ligne (en orange les membres du Cercle VM) - 9 membres, 0 anonyme, 70 invités Afficher la liste
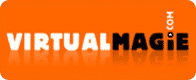
.jpg.f3676384ca95bdad420aee412a56866d.jpg)
.jpg.595b85635aa378e9a2d87bcac46b3adb.jpg)