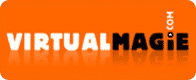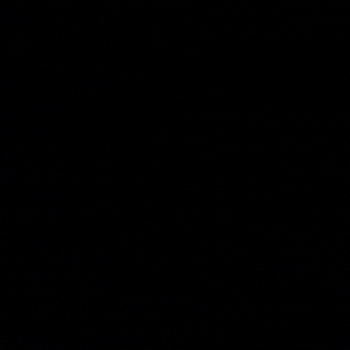-
Compteur de contenus
5138 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Trophée
15
Tout ce qui a été publié par Patrick FROMENT
-

Les Signes de l'Existence de Dieu
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Boumedienne HAMBLI dans Chemins de Traverse
J’ai évoqué à plusieurs reprises cet argument (qui n'est pas une preuve scientifique). Ici : ou là : Il me semble bien que, sans être scientifique, cet argument éclaire bien nos derniers échanges. Ce n’est pas par une preuve scientifique ou par une démonstration logique qu’on en vient à avoir ou non la foi. C'est le cœur qui sent Dieu, et non la raison. Blaise Pascal J'ai formulé cette même idée de l'expérience personnelle encore un peu autrement en novembre 2020 : -

Les Signes de l'Existence de Dieu
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Boumedienne HAMBLI dans Chemins de Traverse
Si, si ! ... Je pense que c’est ce que Christian essaie de me faire dire : il ne peut y avoir de preuve de l’existence de Dieu ! Mais en fait cette question est réglée depuis Kant : Extrait de Toute la philo en BD - Éditions Belin - La boîte à bulles Il n’existe pas de preuves de l’existence de Dieu et il y a une contradiction dans l’expression même "preuve de l’existence de Dieu". En effet, s’il pouvait y avoir une preuve de l’existence de Dieu, Dieu serait alors un objet du monde et non un être transcendant. Par définition la transcendance ne fait pas partie du monde phénoménal et elle ne fait donc pas partie du champ d’étude de la science. Une fois ceci étant dit, cela n’épuise ni le débat, ni la pensée puisqu’il est toujours possible d’échanger des arguments … sauf à considérer qu’il est plus prudent de considérer que ce qui hors du champ d’étude de la science (et non prouvé par la science) n’existe pas. Une sorte de pari de Pascal à l’envers quoi ! -

Les Signes de l'Existence de Dieu
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Boumedienne HAMBLI dans Chemins de Traverse
Pas tout à fait ! Tu dis toi même dans le message dont tu mets le lien que... Il fallait peut-être toutes ces digressions et ces redites pour montrer que la question de l'existence de Dieu n'est pas une question scientifique (de même que la question de la nature de la réalité ou celle de la nature de la conscience). Quant à la séparation (ou au non-empiétement) des magistères, il se pose aussi pour la science : Quand certains scientifiques ou certains militants rationalistes expliquent que la science établit clairement que Dieu n'existe pas, ne sortent-ils pas de leur rôle et ne font-ils pas dire à la science quelque chose qu'elle ne dit pas ? (et qu'elle ne peut pas dire). Bien sûr chacun a le droit, à titre personnel, de partager son intime conviction et même de l'étayer avec des arguments scientifiques (ou philosophiques, ou métaphysiques) mais ce ne sont que des arguments pas des preuves. -

Les Signes de l'Existence de Dieu
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Boumedienne HAMBLI dans Chemins de Traverse
Tu es bien inspiré de mettre le mot démonstration entre guillemets car il n'y avait effectivement aucun syllogisme dans mon propos et aucune intention d'en faire un. J'ai simplement été frappé par le fait que, à la fois, Jacques Arnould et François Euvé relèvent cette alternative qui effectivement, je suis d'accord avec toi, est un faux dilemme ! Les deux auteurs précédemment cités semblent aussi être d'accord avec ça puisqu'ils proposent, justement, une troisième voie qui est celle d'une séparation nette des magistères fondée sur le fait que la question de l'existence de Dieu n'est pas une question scientifique (on ne peut pas imaginer une expérience pour tester la question de l'existence ou de l'inexistence de Dieu). Au passage, notons que cette série de livres et de débats nous fait découvrir un nouveau mot en -isme : Concordisme -

Les Signes de l'Existence de Dieu
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Boumedienne HAMBLI dans Chemins de Traverse
Plus j'ai réfléchi et plus ça me semble clair : Expliquer que la structure de l'univers mise en évidence par la science prouve l'existence de Dieu ou bien expliquer, au contraire, que l'absence de preuves scientifiques de l'existence de Dieu doit nous mener à adopter l'athéisme "jusqu'à preuve du contraire" c'est considérer que c'est la science, et uniquement la science, qui doit guider nos convictions personnelles les plus intimes. Dans un cas comme dans l'autre c'est du scientisme (nous avons parfois épilogué dans ce fil, et dans d'autres, pour essayer d'avoir une définition à peu près claire du scientisme, on commence à s'en approcher). -

Les Signes de l'Existence de Dieu
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Boumedienne HAMBLI dans Chemins de Traverse
Dans la série d'ouvrages autour du sujet de Dieu, la science, les preuves voici le dernier en date : Jacques Arnould, historien des sciences et théologien semble prendre le contre-pied des Bolloré et Bonnassies : Les nouveaux croisés du XXIe siècle en sont persuadés et veulent nous en convaincre, preuves à l'appui : les avancées de la science contemporaine confortent les assertions de la religion. Les tenants du créationnisme, comme ceux de l'Intelligence supérieure « démontrée » par la structure de l'univers, ne doutent de rien et tiennent à le faire savoir. Jacques Arnould s'inscrit en faux contre ce mélange des genres où la foi prend en otage la science en lui faisant dire ce qu'elle ne dit pas.... Jacques Arnould est sur la même position que François Euvé et son "ni le matérialisme scientiste ni l’irrationalité fidéiste" puisque, dans un entretien au « Monde », il renvoie dos à dos les fondamentalistes religieux et les "scientifiques militants et dogmatiques". source Je dois avouer que cette manière de refuser un débat biaisé par les extrêmes me parle bien. Jacques Arnould a même accepté de débattre récemment avec Thomas C. Durand (lui même auteur d'un ouvrage sur cette question de Dieu et les "preuves") ICI ... On ignore s'il le considère comme un "scientifique militant et dogmatique". En tout cas les deux semblent d'accord sur d'accord sur les méfaits de l'OPA que certains courant religieux tentent sur le terrain de la scientificité. La vraie différence semble dans la phrase de Thomas C. Durand : "jusqu’à preuve du contraire, il faut déclarer Dieu innocent : il n’existe pas" (ce qui veut dire implicitement : il ne faut considérer et tenir pour vrai que ce qui est prouvé par la science et il n'y pas de place pour le reste : la spiritualité, la foi...) alors que pour Jacques Arnould la question de l'existence de Dieu est non scientifique, la foi est d'un autre registre que celui de la science et il est nécessaire d'opérer une nette séparation entre science et religion. -

Faites Jaillir le Pouvoir Magique de votre Esprit d'Al KORAN
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Les Étagères Magiques
Attends César ! Tu vas te régaler !!! Pour illustrer très clairement le propos, deux petites photos extraites du début du dernier chapitre de l'ouvrage. Admirez comment l'expérience des enveloppes est enrobée de psychologisme avec un mélange d'astrologie et de cold reading. Du grand art ! Comment l'éthique est sauve aussi : "Je ne vous dirais pas comment je procède mais je puis vous éclairer quelque peu sur le sujet." "Tout ce raisonnement n'est qu'une partie du travail et j'utilise bien entendu d'autres éléments." Bravo l'artiste ! Le mentalisme est-il une discipline ambiguë ? -

Faites Jaillir le Pouvoir Magique de votre Esprit d'Al KORAN
un sujet publié par Patrick FROMENT dans Les Étagères Magiques
J’ai trouvé récemment dans une brocante ce livre d’Al Koran. Faites jaillir le pouvoir magique de votre esprit, édition française de Bring Out the Magic in Your Mind - 1964 et 1965 pour la version française Al Koran est bien sûr le mentaliste du siècle dernier bien connu dans notre univers pour certains de ses perfectionnements et trouvailles (je pense au jeu Al Koran ou au tour du Médaillon, par exemple). La biographie d’Al Koran sur all-about-magicians.com fait référence à l’ouvrage : Ce commentaire est un peu injuste (vraiment un commentaire de magicien ça ! ). L’ouvrage d’Al Koran est un petit traité de développement personnel teinté effectivement de pensée positive, d’un soupçon d’ésotérisme et d’anecdotes personnelles qui me semble d’un assez bon niveau pour un livre écrit il y a plus de 50 ans ! Aujourd’hui encore, certains mentalistes s’aventurent sur ce terrain du développement personnel en publiant des ouvrages parfois à succès. On y retrouve, souvent, le même mélange de pensée positive et d’anecdotes personnelles. L’aura personnelle de l’auteur et le parfum de mystère autour de ses capacités de mentalisme est, souvent, mis en valeur (certainement ce que le site all-about-magicians.com appelle des "éléments publicitaires et promotionnels"). Ce qui a, peut-être, un peu changé depuis les années 60 c’est que les éléments ésotériques ont été remplacés par des éléments de neurosciences (c’est plus dans l’air du temps ! ). De même que le mentaliste ne va pas faire référence à des "instincts extra-sensoriels" dans ses présentations mais plutôt à des compétences psychologiques (on peut noter, néanmoins, que cette tendance popularisée par des mentalistes comme Banachek ou Derren Brown, entre autres, est déjà présente chez Al Koran). -

Polyamour et alternatives au couple traditionnel
un sujet publié par Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse
Allez... Soyons fous... Ouvrons un sujet atypique et, à peu près, jamais évoqué sur VM : Le polyamour ! (et pourtant il y a quelques magiciens polyamoureux ). Le polyamour c'est quoi ? Pour faire court cela consiste à entretenir plusieurs relations amoureuses impliquant des sentiments sans les dissimuler aux différents partenaires. C'est donc un comportement éthique qu'il ne faut pas confondre avec l'infidélité (même si, par ailleurs, il peut y avoir, parfois, un peu d'hypocrisie et que , sous prétexte de polyamour, certaines personnes peuvent être amenées à justifier des comportements non éthiques). Le mode de vie polyamoureux semble marquer des points, notamment parmi les jeunes générations (mais pas que). Plusieurs ouvrages ont été consacrés à cette tendance ces dernières années ainsi que des articles ou enquêtes sur les médias. Pour ouvrir le débat et susciter la réflexion, petit partage d'une conférence que j'ai fait, à Montpellier, il y a à peu près un an (le thème de la conférence est beaucoup plus large que le polyamour puisqu'il s'agit de la question de l'amour et de la liberté mais j'y évoque, néanmoins, le polyamour et les manières alternatives de vivre son couple et son affectivité) : -

Les Signes de l'Existence de la Réalité
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse
Les partisans de la thèse d'une conscience extra-neuronale prennent, en général, l'exemple du poste de radio (ou de la télévision ou de l'ordinateur et d'internet) : Quand le poste de radio est cassé il n'est plus capable de retransmettre tes émissions préférées pourtant elles continuent bien d'être diffusées. Par ailleurs, je pense qu'il y a encore des choses à découvrir sur la question de l'état réel de l'altération de la conscience lors d'une atteinte cérébrale ou d'un coma ou, tout simplement, lors d'une anesthésie générale. Il semble que, dans tous ces cas, il perdure bien une forme de conscience. Perd-on vraiment conscience pendant une anesthésie générale ? (article partiel désolé) Nous pourrions aussi épiloguer sur la conscience dans un état de sommeil profond. Il semble que ce soit surtout une perte de conscience du monde extérieur. Le fait qu'on ne se souvienne de rien ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de conscience mais simplement qu'il n'y a pas d'inscription dans la mémoire. D'ailleurs l'activité cérébrale est intense durant le sommeil profond. J'ai posé une question complexe à Chat GPT (c'est à la mode en ce moment ! ) : Il est encore pas mal sur ce coup là et je le trouve assez nuancé (bien plus que certaines interventions sur ce fil (les miennes comprises ! )) : "La relation entre le cerveau et les pensées est complexe et multidimensionnelle, et il n'y a pas de réponse simple à la question de savoir ce qui est premier entre les deux." "D'un point de vue scientifique, (...). Cela suggère que le cerveau est à l'origine de la production des pensées." "Cependant, les pensées peuvent également influencer l'activité neuronale dans le cerveau (...) ce qui suggère que les pensées peuvent influencer les processus neurologiques." "Le cerveau est à la fois la source et le récepteur des pensées" Il est quand même excellent ce ChatGPT ! ...Faut juste trouver les questions pertinentes (ce qui n'est pas rien car il faut un peu maîtriser le sujet pour trouver les questions pertinentes !). ... Et encore !!!... ChatGPT a du être abreuvé d'une somme considérable de données à tendance matérialiste et physicaliste ! Bon... Il semble, aussi, qu'il s'adapte à la personne qui pose la question voire qu'il donne des réponses susceptibles de lui faire plaisir mais ça me semble quand même assez limité. En tout cas c'est intéressant de lui poser des questions très métaphysiques, très précises et très pointues. Cela permet de tester les limites du système. Je le trouve quand même bigrement étonnant ce ChatGPT. On est bien au delà du "perroquet approximatif", n'en déplaise à Mr Jean-Noël Barrot, ministre délégué au Numérique qui a récemment qualifié ainsi l'intelligence numérique d'OpenAI -

Les Signes de l'Existence de la Réalité
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse
J'essaie de faire vite : Cela ne me semble pas un exemple pertinent : la poésie peut aussi exister sans support matériel et sans encre et papier (c'est les traditions orales). C'est tout le problème : si tout est déterminé par les lois de la physique (y compris la conscience) et si nous ne sommes que des machines un peu sophistiquées réagissant à des stimulis comment expliquer le libre arbitre ? C'est l'argument de la neuroplasticité : nos pensées, nos lectures, nos expériences, nos apprentissages divers modifient notre cerveau. Du coup on a une causalité dans le sens : pensées qui produisent des modifications dans le cerveau. On peut aussi voir la causalité en sens inverse : des phénomènes biologiques, chimiques et électriques dans notre cerveau qui produisent des pensées. Cette question de la causalité et dans quel sens elle s'applique n'est pas tranchée aujourd'hui (...en tout cas en philosophie de l'esprit ... ce qui justifie les débats sur la dualité corps-esprit, la nature de la conscience, les différents monismes etc...). Une position prudente et qui respecte les découvertes des neurosciences, sans pour autant en tirer des conclusions trop métaphysiques, semble être de dire que, effectivement, il existe des liens très étroits entre les pensées et l'activité neuronale... Une corrélation quoi ! C'est d'ailleurs le terme qui est utilisé en neurosciences (les corrélats neuronaux de la conscience). Comme une corrélation n'implique pas une relation de cause à effet dans un sens ou dans l'autre, ça laisse tous les débats ouverts et toutes les interprétations possibles (causalité ascendante, causalité descendante, causalité bidirectionnelle ou pas de causalité du tout (et du coup si pas de causalité du tout comment expliquer la corrélation ?). -

Henri BROCH - Zététique - Art du doute - Science et paranormal
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Christian GIRARD dans Chemins de Traverse
Ces questions sont présentes depuis les débuts de la zététique en France et elles deviennent cruciales en ces temps d’interconnexion et de réseaux sociaux. - Quelle forme doit prendre un militantisme juste pour la raison et la pour promotion de méthode scientifique ? - Qu’est ce qui doit être dénoncé et critiqué ? (et comment ?) - Qu’est ce qui doit être considéré comme relevant de la liberté de conscience de chacun et de ses choix philosophiques ou religieux ? - Comment trouver le juste équilibre entre la dénonciation de certains abus et le respect des croyances ? De nombreux animateurs du mouvement zététique aujourd’hui ont, heureusement, compris que la virulence et les excès de certains sceptiques était contre-productive et desservait leur cause. -

Les Signes de l'Existence de la Réalité
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse
Merci ! Je le crois aussi ! Du coup cela s'appelle faire de la métaphysique. C'est à dire avoir cette capacité à se poser des questions qui sont hors du champ de notre expérience et explorer ces questions dans le cadre d'une réflexion rationnelle (la métaphysique offre cette possibilité d'un dépassement de la raison par la raison elle-même). Et je crois que cette capacité (à faire de la métaphysique) est le propre de l'être humain. Là aussi je suis totalement d'accord ! Il me semble avoir toujours présenté les questions abordées ici comme de la métaphysique, c'est à dire comme une réflexion au-delà de ce qui est observable ou mesurable par les sciences physiques ou empiriques. Quant à tirer des "conclusions définitives", il me semble qu'il serait plus juste de me taxer d'affreux relativiste ! la raison n’est pas le seul outil de création de connaissance : l’art, les révélations, la foi, la tradition, la contemplation ou l’introspection en sont d’autres ; mais la raison est ce qu’il y a de plus pratique et de plus juste pour bâtir des connaissances vraisemblables, poser un savoir commun et évacuer les affirmations les plus fausses. Seul inconvénient : la raison ne permet pas de donner du sens aux phénomènes. La science, rationnelle, n’a pas d’autre but que de décrire, et en aucun cas elle ne donne de portée métaphysique à la réalité. SOURCE : Observatoire Zététique - Qu'est ce que la Zététique ? -

Les Signes de l'Existence de la Réalité
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse
Quand je lis cela j'ai l'impression de lire l'argument matérialiste : - Nous n'avons aucune preuve objective qu'il existe autre chose que le monde physique (déjà cette phrase est, à la fois, et à elle seule, une contradiction, un pléonasme et un non-sens mais passons...) Donc... - Il faut strictement considérer qu'il n'existe que le monde matériel ! Du coup, en sous-titre : - Il ne faut considérer et tenir pour vrai que ce qui est validé par la science. - Se poser des questions auxquelles la science ne peut pas répondre ne mène à rien... - ... Voire c'est dangereux ! Cela présuppose que toute forme de conscience a les moyens (et l'envie et l'intention) de produire des signes (objectifs bien sûr !) qui sont recevables et interprétables par l'être humain. Le critère de validation scientifique qui semble être la clé de voûte de ta pensée est à la fois ta force et ta faiblesse. Car il permet de dire que tout ce qui n'est pas validé par la science n'est que supputation et poésie et, et en même temps, il empêche de penser au-delà de la science. -

Les Signes de l'Existence de la Réalité
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse
Merci @Christian DELAMORINIERE Je ne sais pas si c’est que ChatGPT mais ça fait quelques put*ins d’arguments ! Si nous sommes tout à fait honnêtes ce sont plutôt des arguments qui montrent le caractère très particulier (unique !) de la conscience et le fait que la conscience ne peut pas être réduite à la matière ni à un phénomène comme les autres. Bien sûr un physicaliste non réductionniste et non éliminitaviste pourra toujours arguer que si l’esprit ne peut être réduit à des processus physiques, il est bien le résultat de l’organisation de la matière. Cette dernière affirmation passera tranquillement auprès du lecteur lambda car elle est dans l’air du temps sous nos latitudes. Il faudra déployer toutes les ressources de l’épistémologie et de la philosophie de l’esprit pour montrer que cette affirmation n’est absolument pas "avérée" et fait l’objet de débats. Oui ! ça s'appelle l'incompatibilisme (encore un mot en -isme ). C'est un argument qui a d'ailleurs assez peu été discuté par ici... -

Les Signes de l'Existence de la Réalité
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse
Pffff ! Ok ! Alors : Ma préférence métaphysique va à l'idéalisme philosophique plutôt qu'au matérialisme. Je l'assume et je crois que les choses sont plutôt claires là dessus... ça fait 11 ans, que je nourris ce point de vue, ici, par des références multiples... en précisant à maintes reprises que les questions que je pose sont, pour la plupart, hors du cadre de la science (je crois que j'ai encore fait ça ce matin). Ta question est juste une tentative de réduire une question philosophique (métaphysique) à la science objective. Ce qui est un non-sens ! ...Ou bien, alors, ça voudrait dire qu'il faudrait disqualifier d'office la question sous prétexte que la science ne peut pas y répondre (euh... ce ne serait pas un peu du scientisme ça comme attitude ?). -

Les Signes de l'Existence de la Réalité
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse
Tu me poses la question comme si j’avais soutenu "il est attesté que"… alors que je prends soin, depuis des années, de dire : ceci n’est pas un débat scientifique mais métaphysique. Si j’étais farceur je te demanderais "Où est-il attesté que la seule forme de conscience est celle d’êtres vivants apparus bien postérieurement à la matière ?" et je rajouterais "L’absence de preuve n’est pas la preuve de l’absence !". Ce qui est attesté, par contre, c'est qu’il y a un débat en philosophie de l’esprit pour savoir si la conscience est une propriété émergente du cerveau ou bien quelque chose de plus fondamental et, pour moi, la question fait sens même si cette question est métaphysique et qu’aucune réponse ne peut être apportée aujourd’hui. -

Les Signes de l'Existence de la Réalité
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse
La citation de George Wald que j'ai publié ce matin est issue d'une libre traduction. Le texte intégral est disponible ici (en anglais) : Life and Mind in the Universe Le passage original est celui-ci : Ce qui donne ceci avec l'approximative traduction Google : Tout l'article est intéressant avec des références à d'autres scientifiques comme Schrödinger. Le cas de George Wald est intéressant : Jusqu'à sa 70e année il fût un scientifique modèle qui adhérait, philosophiquement, aux thèses naturalistes et physicalistes avant de changer complètement d'opinion. Il est vrai qu'en 1972 il justifie ses thèses d'une curieuse manière (c'est moi qui graisse) : -

Les Signes de l'Existence de la Réalité
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse
Peut-être que, tout simplement, la question de savoir ce qui est le plus "fondamental" ou ce qui est "premier" entre la conscience et la matière est impossible à résoudre par la science aujourd'hui. Il est même possible que cette question ne soit pas une question scientifique mais plutôt métaphysique. Et il se peut, également, que la question n'ait pas de sens (il serait possible de préciser cela si nous sommes, un jour, capables de définir la nature exacte de la conscience et la nature exacte de la matière - mais ça aussi il me semble (encore !) que ce sont deux questions métaphysiques ). -

Les Signes de l'Existence de la Réalité
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse
Elle est pas mal celle-là aussi : L’esprit n’a pas émergé tardivement au cours de l’évolution de la vie. Il est, depuis toujours, la matrice, la source de la réalité physique et sa condition nécessaire, si bien que la réalité physique se compose de cette matière qu’est l’esprit. George Wald - Professeur de biologie - Lauréat du prix Nobel Life and mind in the Universe - International Journal of Quantum Chemistry - 1984 De grands scientifiques ont émis cette idée curieuse que la matière découle de la conscience (et non l’inverse). Eugène Wigner, un autre prix Nobel en est, également, un bon exemple. Et non : considérer la conscience comme fondamentale (voire plus fondamentale que la matière) ne revient pas nier la matière et l'univers physique. De même que considérer la matière comme plus fondamentale que la conscience ne signifie pas, en général, nier la conscience (je dis "en général" car certains philosophes naturalistes et physicalistes nient la réalité de la conscience (Daniel Dennett par exemple)). Bien sûr ce genre de citation ne prouve rien et il ne s'agit pas d'en faire un argument d’autorité. Il est vrai aussi que ces grands scientifiques ont, généralement, fait ces déclarations en marge de leur stricte activité scientifique. Au fond cela se comprend : la science seule ne permet pas de trancher sur la question de la nature de la conscience. Il s’agit, en fait, d’une question de vision du monde, une question de perspective. -

Les Signes de l'Existence de la Réalité
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse
C'est assez bien résumé oui. En tout cas sur les sujets philosophiques et scientifiques ChatGPT semble être une machine très efficace à produire des billets résumant l'état des connaissances actuelles. Pas étonnant que cet outil ait été interdit dans certaines grandes écoles même si on peut discuter du bien fondé de cette décision et répondre : à l'homme de faire mieux que la machine ! En tout cas une réponse de ChatGPT qui me semble précieuse quand on l'interroge sur la réalité ou sur la "réalité objective indépendante de notre perception" c'est : il n'y a pas de réponse définitive à cette question, car elle dépend de nos présupposés ontologiques et épistémologiques C'est un peu l'idée derrière la tête que j'avais il y a 11 ans en commençant ce fil et le point d'arrivée auquel je souhaitais aboutir. On peut, d'ailleurs, rajouter ceci : Il est impossible de valider et de prouver un présupposé ontologique (l'ontologie est quasiment synonyme de métaphysique)... y compris le présupposé réaliste ou matérialiste... mais on peut, bien sûr, discuter et argumenter la question (ça fait d'ailleurs des siècles que cette discussion a lieu ). -

Les Signes de l'Existence de la Réalité
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse
Quand même !... 256 pages et 11 ans de débats pour se rendre compte que CHATGPT a toutes les réponses ! Existe-t-il une réalité objective indépendante de notre perception ? La question de savoir s'il existe une réalité objective indépendante de notre perception est une question centrale en métaphysique et en épistémologie. Cette question est complexe et suscite des débats parmi les philosophes depuis des siècles. Certains philosophes soutiennent que la réalité est entièrement déterminée par notre perception et notre interprétation. Selon cette perspective, il n'existe pas de réalité objective indépendante de notre conscience. D'autres philosophes soutiennent que la réalité existe indépendamment de notre perception et que nous avons la capacité de connaître cette réalité objective. Selon cette perspective, la réalité est accessible à travers notre expérience sensorielle, mais elle existe indépendamment de notre conscience. En fin de compte, il n'y a pas de réponse définitive à cette question, car elle dépend de nos présupposés ontologiques et épistémologiques. Certaines personnes peuvent affirmer que la réalité objective existe indépendamment de notre perception, tandis que d'autres peuvent soutenir que notre perception est tout ce qui peut être connu avec certitude. Les réponses dépendent donc des perspectives et des hypothèses philosophiques de chacun. L'expression "existence de la réalité" a t elle un sens ? L'expression "existence de la réalité" peut avoir plusieurs sens, selon le contexte dans lequel elle est utilisée. En métaphysique, cette expression peut se référer à l'existence d'une réalité objective indépendante de notre perception et de notre conscience. Elle peut également être utilisée pour désigner l'ensemble des choses qui existent dans le monde physique. Cependant, il est important de noter que cette expression peut également être sujette à interprétation et à débat philosophique. Certains philosophes soutiennent que la réalité n'est pas une entité ontologique distincte, mais plutôt une construction mentale basée sur notre perception et notre interprétation des choses. Selon cette perspective, l'expression "existence de la réalité" pourrait ne pas avoir de sens absolu. En somme, l'expression "existence de la réalité" peut être interprétée de différentes manières selon le contexte et les présupposés philosophiques en jeu. -

Télépathie Réelle de Patrick FROMENT
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Marc BARBAT dans Les Étagères Magiques
Je viens de voir qu'un sujet est consacré aux réponses magiques sur CHATGPT, c'est assez hilarant ! : -

Les Signes de l'Existence de la Réalité
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Patrick FROMENT dans Chemins de Traverse
En tout cas CHATGPT semble très efficace pour compiler des données et livrer l'état d'une connaissance à un moment T... avec tous les biais que ça suppose (cf l'article wikipédia). Sur les deux questions posées plus haut, j'aurais eu du mal à faire mieux. Intéressant aussi ça : Dans un autre fil je m’interroge sur l'impact que cette technologie pourrait avoir sur la magie... A suivre ! Et pour revenir au sujet de ce fil , Elon Musk est un des créateurs de la société Open-AI, Or... Pour Elon Musk, ce que nous croyons être la réalité n'est qu'une simulation -

Télépathie Réelle de Patrick FROMENT
Patrick FROMENT a répondu à un sujet de Marc BARBAT dans Les Étagères Magiques
Je m'amuse avec CHATGPT ce soir ! J'ai posé à CHATGPT la question suivante : Qu'est ce que "télépathie réelle" de Patrick Froment ? La "télépathie réelle" est une théorie avancée par Patrick Froment, un parapsychologue français, qui prétend que les humains sont capables de communiquer par télépathie de manière régulière et fiable. Selon cette théorie, la télépathie est une capacité innée de tous les êtres humains qui peut être développée et utilisée avec une formation appropriée. Froment affirme que la télépathie peut se produire de plusieurs manières, notamment par la transmission de pensées d'une personne à une autre, par la perception de sensations physiques ou émotionnelles d'une autre personne, ou par la réception de messages de l'au-delà. Il a également proposé des techniques pour développer la télépathie, telles que la méditation, la visualisation et la pratique de la concentration mentale. Cependant, la théorie de la "télépathie réelle" n'a pas été scientifiquement prouvée et est considérée par de nombreux scientifiques et sceptiques comme une pseudoscience. Les preuves de la télépathie sont très faibles et il n'y a pas de preuves solides pour étayer l'existence de cette capacité. En résumé, la théorie de la "télépathie réelle" de Patrick Froment est considérée comme une théorie non prouvée et controversée dans le domaine de la parapsychologie et de la science en général. Énorme !!! LooooL... Bon ça va... Il y a encore des progrès à faire ! J'ai, par ailleurs, posé plusieurs questions magiques à CHATGPT du style : - Comment fait un magicien pour couper une femme en deux ? - Comment David Copperfield fait-il pour voler ? etc... Pour l'instant je pense que les magiciens n'ont pas trop de soucis à se faire. Sur ce sujet CHATGPT ne fait que donner des réponses plutôt très approximatives et imprécises. Quelques secrets semblent encore bien gardés. Difficile de prévoir, néanmoins, comment cette technologie va évoluer...
-
Qui est en ligne (en orange les membres du Cercle VM) - 8 membres, 0 anonyme, 95 invités Afficher la liste