Comment accroître sa Créativité ?
Annonces
-
Messages
-
Par Michel DARLONE · Publié le
Etat neuf 39 euros Fdpi France Version française sur le tarot de Marseilles. édition normale : format 13 x 21 cm, couverture souple, reliure collée, papier blanc. Pour offrir une sensation inoubliable aux gens, il faut leur parler de leur sujet préféré : eux-mêmes. Le Tarot est parfait pour ça : ses illustrations évocatrices fascinent le public depuis des siècles. Mon nouveau livre, "Le Tarot du Diable", contient plusieurs démonstrations de mentalisme basées sur le Tarot : trois effets formant une routine très personnelle, un quatrième effet de groupe, pensé pour le salon ou la scène, et un cinquième effet, garantissant que la participante conservera votre carte de visite pour toujours. Zéro technique ou mémoire, zéro complice ou technologie, zéro truc psychologique approximatif. Prenez un jeu de Tarot normal (jeu non fourni), un peu de papeterie, et vous êtes prêt ! Ce livre détaille l'expérience vécue par le public, mon script complet, des exemples vidéo, et des variantes en fonction de votre niveau et de votre budget. J'ai même créé une appli en ligne gratuite pour vous entraîner. "Le Diable est dans les détails" et, justement, je n'en ai jamais révélé autant, avec 200 pages et plus de 200 illustrations. Si le Tarot lui-même ne vous intéresse pas, ce livre vous apprendra quand même des techniques simples, abordables et efficaces pour récupérer des informations, gérer des sorties multiples, théâtraliser vos révélations, et construire votre texte. J'ai écrit "Le Tarot du Diable" en deux versions : Tarot Rider-Waite, et Tarot de Marseille, en fonction du Tarot que vous préférez utiliser. Les effets sont les mêmes dans toutes les versions, seul le jeu de Tarot change. Et tous les effets de ce livre fonctionnent dans n'importe quelle langue. 5 effets, 200 pages, en français, avec plus de 200 illustrations. Le livre vous donne accès à des vidéos en ligne, et des téléchargements. Aucun jeu n'est fourni, tous les effets utilisent un Tarot normal. -
Par Nicholas RYL · Publié le
Et je me permets d'insister sur une différence avec la v1, qui est vraiment important àprendre en compte si on effectue une comparaison avec les autres itr, c'est la possibilité d'interchanger les bobines sans aucune difficulté (avec des épaisseur différentes de fils) Ça laisse imaginer la possibilité de passer d'effets avec des objets légers ou proches, à des choses plus imposantes ou éloignées (du coup fil plus épais) Du coup faire un effet de gravité nécessitant une architecture compliquée à mettre en place, à des effets plus "basiques" sans avoir plus de 2 itr (ce qui peut mettre un peu en perspective le prix) -
Par David BERTON (Gunnm) · Publié le
C’est la version calorique Graisse en sauce
-
-
Qui est en ligne (en orange les membres du Cercle VM) - Afficher la liste
-
Statistiques des membres
-
Statistiques des forums
-
Total des sujets84.7k
-
Total des messages682k
-
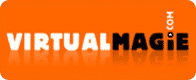





.gif.43fd222fbabeddb5a351e8e6c6887e3f.gif)


(2).gif.df27bc07cef0e29200c3a3b4a6f86666.gif)
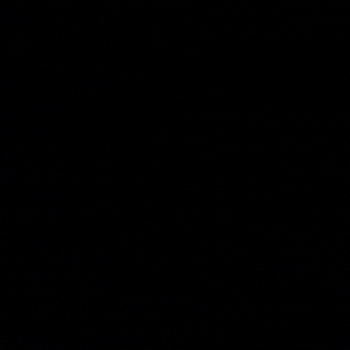
Recommended Posts
Rejoins la conversation !
Tu peux publier maintenant et t'enregistrer plus tard. Si tu as un compte, connecte-toi maintenant pour publier avec ton identité.