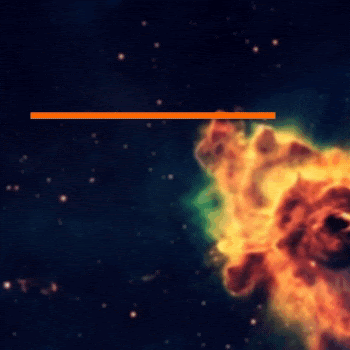-
Compteur de contenus
954 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Trophée
30
Tout ce qui a été publié par Marc PAGE
-
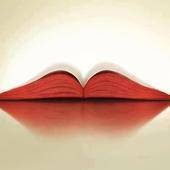
Joyeux anniversaire Tonton Gaëtan BLOOM
Marc PAGE a répondu à un sujet de Ali NOUIRA dans Forum Général
Joyeux anniversaire Gaëtan ! Ma chérie et moi venons vous voir prochainement en close-up et en scène à Semur en Auxois, l'occasion de vous offrir un verre si vous avez un peu de temps et l'envie entre les deux prestations (nous ferons un petit tour en ville car le coin semble mignon comme tout). A bientôt ! -
Daryl dans l'un des premiers volumes de son encyclopédie des cartes en vidéo. En fait, c'est une petite "tape" bien sèche pour finir d'enfoncer la carte du spectateur (jusque quelques millimètres) qui la fait immédiatement ressortir en saillie interne pour ensuite prendre une brisure sur ou sous elle et couper en une ou plusieurs fois, tout de suite ou en créant une parenthèse d'oubli.
-
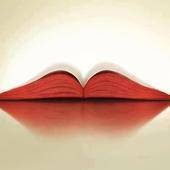
Énigme coquine (?) mais simple
Marc PAGE a répondu à un sujet de Christian GIRARD dans Quizz magique
Un jeu baisé est tout simplement un jeu qui s'est fait tripoté toute la journée : après quelques coupes (de champagne), un peu d'accordéon (fioriture), un bel effeuillage (autre nom pour un strip tease) avant une queue d'aronde (nom français pour désigner le mélange américain) qui aboutira sur une belle union des deux parties. -
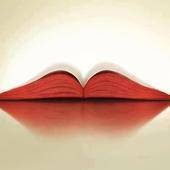
Liquide qui coulerait "lentement"
Marc PAGE a répondu à un sujet de Jean-François JOURDAIN dans Forum Général
L'utilisation de la glycérine comme étant "l'ingrédient miracle" pour faire des bulles de savon est largement survendue. Ce n'est absolument pas le point essentiel et que ce soit pour faire de la sculpture de bulles comme le célèbre Tom Noddy ou pour faire des bulles géantes comme Fan ou Ana Yang, on peut parfaitement se dispenser de glycérine. La chose vraiment primordiale est le choix du tensioactif (le produit vaisselle utilisé en gros). Certaines marques vont beaucoup mieux que d'autres mais malheureusement pour nous la plupart ne se trouvent pas ou pas facilement du moins en France. Il faut importer. Ensuite, il faut un lubrifiant, en particulier si on veut faire des bulles avec les doigts ou pouvoir toucher à mains nues les bulles. Là aussi, certains vont mieux que d'autres. Enfin, utiliser plutôt de l'eau du robinet que de l'eau distillée. Là aussi, c'est une fausse idée véhiculée par beaucoup que l'eau distillée convient mieux. Les minéraux contenus dans l'eau du robinet (eau minérale) participent au renforcement de la structure qui n'est autre qu'une mince couche d'eau entre deux couches de tensioactif. L'eau distillée sera plus adaptée dans certains cas uniquement : si l'eau du robinet que vous avez est trop dure (trop riche en minéraux, ce n'est pas bon). Lorsqu'elle est utilisée pour les bulles, la glycérine joue le rôle d'épaississant et c'est souvent pour ceux qui veulent faire de très grosses bulles en extérieur. Pour les sculptures de bulles, elle n'a pas beaucoup d'intérêt et si on en met un peu trop, au contraire, elle rendra vos bulles plus fragiles. Quant à ce qu'est la glycérine commerciale, c'est du glycérol, souvent d'origine végétale, que l'on hydrolyse. Ce que vous allez acheter s'appelle donc souvent "Glycérine végétale 99,5%". Mais grosso-modo, glycérol et glycérine désignent la même chose. Disons que la glycérine, c'est du glycérol obtenu : - soit par saponification, c'est-à-dire une réaction chimique entre de la soude et un corps gras (huile ou graisse) d'origine végétale - soit par hydrolyse d'un ester que l'on trouve dans certaines graisses ou huiles d'origine animale ou végétale A ma connaissance, on utilise plus le terme de glycérine au niveau commerciale et lorsque l'huile utilisée est d'origine végétale. En chimie, on va plutôt dire glycérol pour bien montrer qu'il s'agit d'un alcool (un triol exactement puisque cette molécule comporte trois fonctions alcool). Vous allez peut-être faire les gros yeux en voyant que la glycérine peut être préparée en utilisant de la soude qui est une espèce chimique très corrosive (base forte) mais vous n'avez aucune crainte à avoir sur le produit de réaction obtenu, c'est-à-dire le glycérol ou glycérine. Ce dernier est vraiment sans danger à manipuler. Ne vous amusez pas à faire votre propre glycérine. Les saponifications nécessitent d'avoir le bon matériel (verrerie adaptée, filtre avec aspiration type Büchner voir mieux, hotte aspirante, etc...), du temps, ont souvent un mauvais rendement (surtout en amateur !) et la glycérine n'est pas hyper bon marcher mais elle ne coûte pas une fortune non plus et vous n'y gagnerez rien à la faire vous même. -
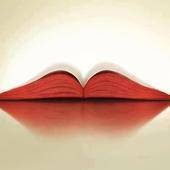
Liquide qui coulerait "lentement"
Marc PAGE a répondu à un sujet de Jean-François JOURDAIN dans Forum Général
Un peu d'humour de temps en temps aère ce genre de discussion donc je ne l'ai perçu comme du trolling en lisant les dernières interventions. Cela devient embêtant quand la parenthèse humoristique s'étale sur au moins deux pages mais là ça allait. Enfin pour moi, la limite serait là. Sinon, pour un de mes projets, je viens de recevoir de la glycérine végétale à 99,5%. C'est un liquide limpide, de viscosité élevée, sans danger pour la peau ou les bronches (ce n'est pas à avaler non plus, attention !) et...soluble dans l'eau ! Je viens de vérifier cette propriété en ligne et dans ma cuisine. La glycérine se lavera donc bien mieux que l'huile car elle peut être emportée avec de l'eau. De plus, étant soluble dans l'eau, il est fort probable que les colorants alimentaires soient solubles dans la glycérine (pour ceux qui voudraient avec un liquide visqueux, sans danger, facile à nettoyer et coloré !) mais cela reste à vérifier et je n'ai plus de colorant alimentaire sous la main mais je pourrai tester cela au labo. SI il y a des collègues de physique-chimie sur le forum, on peut donc remplacer l'huile par de la glycérine dans nos éprouvettes pour l'étude de la chute d'une bille (entre autre). Sa limpidité facilitera les mesures ou pointages sur la vidéo et ce sera plus facile à nettoyer à la fin. Reste le fait que la glycérine est un peu plus cher que l'huile... -
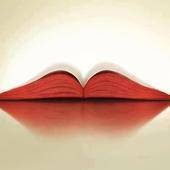
Liquide qui coulerait "lentement"
Marc PAGE a répondu à un sujet de Jean-François JOURDAIN dans Forum Général
Je doute que M. JOURDAIN cherche encore une réponse à sa question au bout de 20 ans mais pour ceux qui chercheraient un tel liquide, à savoir un liquide : - avec une viscosité élevée MAIS - facile à nettoyer ou du moins plus facile à nettoyer que de l'huile Pour qu'un liquide soit facile à nettoyer "normalement" (=avec une éponge, de l'eau, une feuille de papier essuie-tout), il faut qu'il soit soluble dans l'eau sinon il sera difficile à nettoyer, c'est-à-dire qu'un tensioactif comme du savon ou du produit vaisselle sera nécessaire pour l'emporter ensuite avec de l'eau (un tensioactif est une molécule avec une partie qui a une affinité pour l'eau appelée la partie "hydrophile" et une partie "hydrophobe" qui n'est pas soluble dans l'eau mais va facilement se fixer sur l'huile, les graisses). On cherche donc un liquide soluble dans l'eau avec une forte viscosité et non toxique. A priori, je proposerais du miel de mauvaise qualité : non toxique, visqueux, facile à se procurer et en cas d'échec, ce sera tartine de miel tous les matins ! Quant au nettoyage, il sera assez facile si vous prenez du miel bas de gamme car ce dernier est mélanger à des sirops (de glucose entre autre) qui le rendent plus soluble dans l'eau que le vrai miel qui ne l'est pas. En dehors du miel bas de gamme, une solution très saturée d'eau sucrée devrait convenir aussi. Il faut chercher à dissoudre un maximum de sucre en poudre dans de l'eau en la faisant chauffer dans une casserole (un peu comme pour préparer certains glaçages). J'avais aussi pensé aux gélatines et à l'Agar Agar que nous utilisons parfois en chimie et qui n'est pas dangereux mais dans ce cas, on se retrouve vraiment avec de la gelée qui ne s'écoulera pas. Bref, il n'y a pas de solution miracle à ce problème sans faire une concession sur l'un des deux principaux paramètre du cahier des charges : soit avoir un liquide très visqueux mais difficile à nettoyer, soit un liquide plus facile à nettoyer mais moins visqueux. Quant au mercure, évidemment on oublie car il est cancérigène et de plus, il ne répondrait pas au problème car étant "non mouillant", il roule comme une bille sur les surfaces (c'est d'ailleurs assez surprenant à voir). Après, il est vrai que vous n'allez pas attrapez un cancer en en manipulant même à mains nues de toutes petites quantités. Il faut y être exposé assez longuement et régulièrement, au dessus d'une cuve de quelques litres remplie. Le risque est effectivement lié aux vapeurs de mercure et plus il fait chaud plus il y en aura. Je n'encourage pas à en manipuler pour autant ! Je dit juste qu'il faut relativiser par rapport à certaines choses très alarmistes que l'on peut lire parfois là dessus. C'est dangereux, oui mais il est toujours possible d'en manipuler dans de bonnes conditions : avec un compte-goutte, sous une hotte, sous une atmosphère assez fraîche, on peut réaliser l'expérience du dépôt de quelques gouttes sur un plan incliné et les récupérer directement dans le flacon compte-goutte. -
Pour "HÔ", j'aurais pu le voir. Par contre, je ne pouvais pas savoir pas que derrière "MCD" se cachait le nom de "Mercadal" donc il ne faut pas m'en vouloir pour celui-là. Sinon, toujours dans l'agglomération troyenne : Lennart GREEN et Sébastien NICOLAS
-
Belles trouvailles ! Je n'ai pas compris ou ne connais pas les deux derniers par contre.
-
En me baladant dans les rues de Troyes, je me suis rendu compte que plusieurs noms d'enseignes, de commerces, de rues ou de places correspondaient à des noms de magiciens. En voici quelques exemples : Juan Tamariz, Gus, Luc LANGEVIN, Lance BURTON, @David ETHAN, @Kris CAROL A vous d'en trouver dans votre ville (en précisant votre ville).
-
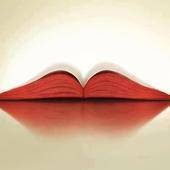
Meilleures Auto / Self Lévitations | références
Marc PAGE a répondu à un sujet de Lawrens GODON dans Forum Général
Je confirme, des milliers et même des millions de personnes ont déjà lévité grâce à ce phénomène (la supraconduction), ils ont pris le MAGLEV dont la technologie est bien vulgarisée ici : Pourquoi ce train ne se développe pas plus ? A cause de son coût principalement. Et ce dernier est principalement lié au fait qu'il faille refroidir les aimants à des températures très basses pour que la supraconduction ait lieu. C'est très gourmand en énergie. Sinon, pour s'amuser un faire un petit train qui s'en rapproche à la maison (mais qui ne fait pas intervenir la supraconduction, uniquement l'induction) : Et pour les fans de cet ancien jeu vidéo : -
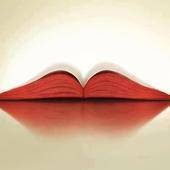
énigmes de GDeleur (Twitter)
Marc PAGE a répondu à un sujet de Aurélien B. (TanMai) dans Quizz magique
Voltaire aurait répondu à l’invitation de Frédéric II de Prusse en son palais d’été de Sans-Souci (près de Berlin) : 6 Ga 7 Le roi lui avait adressé le mot suivant : P/Venez à 6/100 Essayez de traduire d'abord le Ga (sans considérez les chiffres) pour comprendre le message de Voltaire. Pour le mot du roi, c'est plus facile à partir de ce que j'ai écrit. -
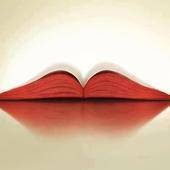
Jeu : ruinez le nom d'un magicien
Marc PAGE a répondu à un sujet de Bruno CREISMEAS dans Quizz magique
Juan TAMONRIZ ? Dany DESORTIZ ? DURADI ? Ed MAYO ? Bon ben, on a de quoi se mettre A TABLE. -
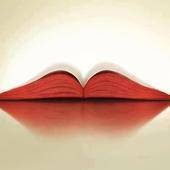
Appearing Glass de Steve THOMPSON
Marc PAGE a répondu à un sujet de Thomas dans Les Étagères Magiques
"Tostmaster" n'a pas ce problème. Deux contraintes seulement mais qui pour moi n'en n'étaient pas vraiment : 1) Il faut porter une veste ou un veston, un sweet ouvert, bref, dites vous que c'est comme un spash bottle ou la plupart des gimmick déjà cités ici sauf que ça bouge beaucoup moins facilement : rien d'élastique, rien à régler par rapport à votre taille, vous l'installer instantanément sur n'importe quel pantalon pas trop lâche, vous mettez en place ou enlevez le verre très rapidement du gimmick, il n'y a pas de résistance (car pas d'élastique, ni d'aimant, ni de système qui pince). A noter que vous pouvez vous servir du gimmick sur scène pour une charge qui ne soit pas corporelle. 2) Vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel verre, il faut que ce soit un verre avec un pied : verre à vin, flûte, coupe de champagne (vide par contre pour cette dernière sinon vous risquez de la renverser ou alors il faudra la boucher). Autre détail : vous pouvez en avoir plusieurs sur vous sans problème. J'ai déjà travaillé avec deux au début (un close-up où je n'avais fais la production que deux fois dans la soirée en laissant la flûte à chaque fois) mais quand je me suis aperçu que je pouvais vraiment recharger rapidement en replaçant mon foulard dans ma pochette, je n'en n'ai conservé plus qu'un et ne pas laisser la flûte à la table ne me gêne pas. D'ailleurs la fois où je les avais laissées, les spectateurs ne les avaient pas bues, ils avaient juste trempé les lèvres pour vérifier si c'était vraiment du champagne. Et puis je trouve ça sympa de trinquer avec les spectateurs avant de quitter une table. -
J'ai répondu à Gaëtan en MP en pointant la description de l'historique du Delta Gimmick page 2 dans le livret fourni avec, historique que Sylvain MIROUF a redonné à chacune de ses conférences. Pour ce qui est de l'historique de l'Intercessor, Gaëtan le présente en détails dans la 5ème session du coffret dvd de l'EMC 2012 et dans le dvd fourni avec l'Intercessor 2.0 (que je ne possède pas par contre). Si quelqu'un a les notes "Eurêkartes" de Sylvain MIROUF, ce dernier affirme y décrire le "principe du guide". Il serait intéressant de savoir si il y décrit un gimmick en métal ou réalisé à partir de deux cartes à jouer collées. Si quelqu'un a la routine "The missing digit" commercialisée par Ken BROOKE et si son contenu est bien tel que le décrit Gaëtan dans la session 5 de l'EMC 2012 (je n'ai pas de doute personnellement mais cela montrera une antériorité de l'idée même d'un gimmick remplissant cette "fonction"). Voilà. Je voulais juste donner des éléments vous permettant de vous forger votre propre avis puisque la seule rencontre débat sur le sujet entre les deux principaux intéressés n'a jamais eu lieu, Sylvain MIROUF l'ayant refusée. D'autre part il est toujours intéressant de lire l'historique d'une routine ou d'un gimmick, ce sont de merveilleux exemples concrets de processus créatifs, loin des théories parfois fumeuses. Pour rester dans le fil de la discussion, je pense toujours qu'il n'y a pas plagiat dans cette histoire. En revanche, qu'ils se soient influencés mutuellement est possible lorsqu'on voit de quoi chacun est parti et sur quoi ils ont abouti. Cela donne vraiment l'impression d'un chassé croisé d'idées qui a été productif malgré le conflit. Comprenez bien que mon but n'est en aucun cas d'arriver à dire qui est le "gentil" et qui est le "méchant" dans l'histoire* mais bien d'inviter à la recherche et de montrer qu'au final, chacun des "duels commerciaux" cités précédemment (Delta/Intercessor, Window/Window pro et Supended dimension/French topit) a été bénéfique pour la magie et pour leurs auteurs car, malgré les affrontements, tout ces articles ont eu et ont encore du succès en boutique. *encore une fois je les pense honnête tous les deux mais Sylvain est beaucoup agressif à l'égard de Gaëtan que l'inverse dans ses écrits et lors de ses conférences. Et encore une fois, je ne désespère pas à l'idée qu'ils se réconcilient.
-
La mole : une notion dure à faire passer.
-
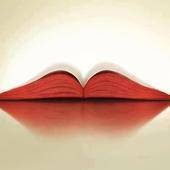
Frais de Douane Exagérés
Marc PAGE a répondu à un sujet de Jean-Jacques MEYER (Edler) dans Forum Général
L'affaire est tout de même tendue...indirectement. -
Duraty, "Magie pour rire" tome 2.
-
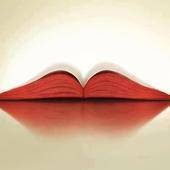
L'Inde est l'épicentre des activités extra-terrestres
Marc PAGE a répondu à un sujet de Gérard BAKNER dans Chemins de Traverse
Mais si les extra-terrestres existent ! En voici deux : Et dans cette vidéo ils sont même complètement "en dehors de l'Univers". -
A cette adresse, vous pouvez suivre la position de Voyager I et Voyager II, les deux objets que l'Homme a envoyé le plus loin de lui et qui traversent aujourd'hui un espace sur lequel on a des tas de questions et les premières réponses ou confirmations : https://voyager.jpl.nasa.gov/ Ces deux sondes ont un disque en or avec nos coordonnées et des informations sur l'humanité : https://voyager.jpl.nasa.gov/golden-record/golden-record-cover/ Sinon, voici la vidéo d'introduction que j'utilisais devant mes élèves pour aborder le chapitre sur ce qu'est une "année de lumière", expliquer la phrase "voir loin, c'est voir dans le passé" et comprendre l'intérêt des puissances de 10 pour considérer des distances et des masses très élevées (ou très petites) : Les astres présentés dans cette vidéo sont classés par taille et ne sont pas uniquement des astres de notre système solaire. L'année de lumière y est bien visualisée, par comparaison à taille d'un point lumineux central qui n'est autre que la plus grosse étoile jamais observée par l'Homme dans l'Univers et qui est déjà considérablement plus grande que notre Soleil. Autre intérêt, cette vidéo va jusqu'à représenter les limites observables de l'Univers (Laniakea, Web cosmique) et l'hypothèse du Multivers. Bien entendu, on se sent tout petit, insignifiant après cela mais comme je le disais à chaque fois, il faut surtout se dire que l'Homme, aussi insignifiant qu'il soit au milieu de tout cela, est parvenu, depuis son demi grain de poussière à imaginer, théoriser et même observer déjà pas mal des objets extrêmement lointains présentés. Et pour revenir à Venus, elle est surnommée la soeur jumelle de la Terre car elle a à peu près la même taille (mais est très inhospitalière malheureusement).
-
Le visuel des boîtes d'allumettes est assez sympa et j'aime assez la chute de cet enchaînement : Cet enchaînement simple avec des briques a un double effet qu'on ne peut pas aussi facilement obtenir avec des dominos :
-
La version cercueil à 1min55s dans cette compilation aurait bien sa place au Surnateum comme jouet pour Vampire : Et si vous ne savez pas quoi faire le week-end avec vos enfants : Et une petite à faire pour Noël :
-
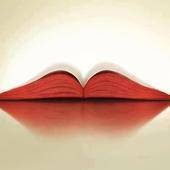
Sur la route de Compostelle, un pèlerin passe devant un poirier...
un sujet a répondu à Marc PAGE dans Quizz magique
Pour l'énigme : Le pélerin se méfie d'une telle tentation ? La méfiance est de mise à l'époque, surtout par rapport à quelque chose de si tentant, et la gourmandise est un péché. Pour répondre à ta question Mickaël : - si c'est de la composition de la Saint-Jacques dans le sens "Qu'est-ce qu'il y a dans la coquille ?" : - si c'est vraiment la composition de la coquille elle-même (vide) que tu recherches : c'est essentiellement du carbonate de calcium (le même constituant principal de la craie) que l'animal "fabrique" pour faire sa coquille et ce carbonate de calcium existe sous deux formes cristallines différentes: la calcite et l'aragonite. A ma connaissance il y toujours un peu des deux formes cristallines dans les coquilles des crustacés. - si c'est la composition de la coquille Saint-Jacques en termes de molécules (lipides, glucides, protéines, minéraux) que tu es curieux de connaître : https://sante.lefigaro.fr/mieux-etre/nutrition-aliments/saint-jacques/composition Ce que l'on consomme est donc le muscle et lorsqu'il y a le corail avec, ce dernier est donc une partie de l'appareil génital (l'ovaire). Bon, corail ça passe mieux en termes culinaires. -
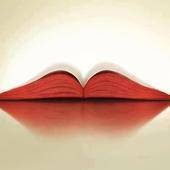
Gus dans Télématin sur France 2 le 080623
Marc PAGE a répondu à un sujet de Christian DELAMORINIERE dans Forum Général
Et là dessus je te rejoins complètement : Gus ne s'est pas trop foulé pour ce passage télé. Après est-ce que ce qu'il a présenté est mauvais ? Non. Ce n'est même pas médiocre ou moyen. C'est bien présenté (il n'y a pas eu de raté, pas de flash malencontreux, il s'exprime bien, simplement, véhicule une bonne image de la magie). Mais il n'y effectivement pas de gros investissement de sa part dans la préparation de ce passage. D'un autre côté, il vient faire la promotion de son spectacle. Il n'est pas obligé de présenter quoi que ce soit. D'autres se contentent de répondre à quelques questions et de présenter leur clip promotionnel (et je ne leur ferai pas le reproche non plus). J'ai plus d'estime pour ceux qui vont se casser un peu plus pour leur passage télé mais cette démarche ne me choque pas. Tant qu'un passage télé donne une bonne image de la magie, ça nous est profitable à tous. Je ne trouve pas que le passage de Gus donne une mauvaise image de la magie mais comme toi, je préfère le passage de Kostya KIMLAT et je trouve qu'il a eu plus de mérite si on fait encore une fois cette comparaison précise entre ces deux passages télé. Vraiment, le seul bémol que j'exprime est le fait qu'il serait élégant de citer Dan HARLAN d'une part (ça ne coûte rien) et le petit détail par rapport à son flip move mais ce dernier est dérisoire. Je ne sais pas si "Cardtoon" figure dans son spectacle (auquel cas il y aurait une logique) mais sinon, je trouve judicieux qu'un artiste présente une routine issu du spectacle dont il fait la promotion. Le but étant d'attirer le public sur UN spectacle précis... Mais là aussi, présenter une routine qui ne figure pas dans le spectacle n'est pas un réel problème. On a au moins un aperçu de ce que l'artiste est capable de présenter. Pour ne pas rester figer autour de ces deux passages télé, je viens de regarder les autres vidéos (le deuxième passage de Kostya KIMLAT, celui de Dani DAORTIZ, celui de Jason Ladanye et celui de Michael VINCENT). Dani DAORTIZ est un extraterrestre. Il emporte tous les publics (profanes ou magiciens) car son personnage (lui en fait car je pense qu'il est exactement le même dans la vie) est déroutant, drôle, charismatique et les effets sont hallucinants car il ne semble vraiment pas être habile aux yeux des profanes. Il a un rythme incroyable et gère ses spectateurs comme personne. Il est vraiment la fusion de Lennart GREEN et Juan TAMARIZ mais avec des mimiques, des gags, des approches de classiques bien à lui. En conférence, c'est le genre de magicien où on préfère voir d'autres démonstrations plutôt que d'avoir l'explication de ses routines. Cela veut dire qu'il a porté la magie à un tel stade pour nous qu'il a réussi à refaire de nous, l'espace d'un instant, des profanes. Concernant le second passage de Kostya KIMLAT, son triomphe est je pense, plus marquant pour les profanes que sa routine de carte à l'élastique + production des autres cartes du carré car il ne semble pas manipuler et les profanes vont estimer que le travail pour tout remettre dans le bon sens doit être un assez long et fastidieux, impossible en quelques secondes et juste en étalant les cartes d'une main à l'autre comparé à sortir les cartes d'un carré qui, dans l'esprit des profanes doit être faisable pour un bon manipulateur et même si là aussi, les cartes sont juste étalées d'une main à l'autre. Personnellement, je préfère quand même l'effet de la carte à l'élastique et la production des 3 autres cartes du carré (deux climax enchaînés de manière très direct, c'est ce qui me plaît ici) que son triomphe mais là aussi, je suis persuadé que côté profanes, c'est le triomphe qui plaira le plus des deux tours pour la raison que j'ai décrite ci-dessus : cela semble plus impossible à réaliser, il semble y avoir plus de travail à fournir (et ce n'est pas faux !) et donc c'est plus impossible aux yeux des spectateurs. Pour Jason LADANYE, ses routines sont propres mais plus classiques, plus sobres et le personnage moins charismatique. Il marquera à mon avis moins les esprits que DAORTIZ, KIMLAT ou même GUS si on compare ces passages télé précis. Et Michael VINCENT, le puriste. Je pense honnêtement que c'est le plus bosseur du "lot". Cet artiste cherche la perfection technique, la pureté du geste. Il caresse les cartes. Mais là aussi, comme il est moins charismatique que les autres, je pense qu'il marque moins les profanes. C'est plus difficile de marquer les esprits avec un personnage calme et sobre en close-up, ordinaire, donc banal ou alors il faut tomber dans l'excès inverse : le personnage très mou, qui semble n'avoir rien à faire de ce qu'il présente (Markobi est pour moi un Dani DAORTIZ au ralenti, avec un autre personnage, d'autres gags mais une grande similitude dans les effets et l'état d'esprit au niveau d'attitude et de la construction des routines). Sur scène, il y a des différences. Les spectateurs s'attendent à ce qu'un magicien manipulateur (un prestidigitateur) joue sur la vitesse et un artiste qui arrive calmement, vêtu de manière élégante, qui sait se placer et se déplacer correctement dans la lumière va être immédiatement interprété comme "attention, je sens que ça va être bon". Quand on découvre Fred KAPS, Marco KAVRO, Channing POLLOCK, Norm NIELSEN ou Jerôme MURAT après ouverture des rideaux, avant le premier effet, ça "sens déjà" très bon. Ce n'est pas toujours vrai après mais tout cela pour dire que le charisme est un point essentiel et qu'en fonction du type de public mais aussi de la situation et du type de magie présenté, l'analyse d'un numéro est différente car ce à quoi les spectateurs profanes s'attendent est différent. Il faut rompre avec ce à quoi les profanes s'attendent si on veut marquer les esprits mais leur donner tout de même certaines images attendues au cours du numéro (retrouver une carte, couper une femme en deux, faire un accordéon avec les cartes, etc...). En close-up, les spectateur s'attendent à voir des cartes donc je ne commence jamais par une routine de cartes mais j'en utilise après car ils les attendent quand même. Cela les déroute, les séduit et ensuite on leur donne ce qu'ils attendent. En grande illusion, les spectateurs s'attendent à la femme coupée en deux, à la lévitation d'une femme à l'horizontal, à une caisse avec épées, pics et/ou lames. Si vous arriver avec une chaise ou une machinerie pas possible, quelque chose qu'il ne peuvent pas reconnaître comme quelque chose d'habituellement utilisé en grande illusion, vous les dérouter. Mais ensuite, au cours du spectacle, cela n'empêche qu'ils aimeraient bien voir la femme coupée en deux. Ils ne l'ont souvent jamais vu en vrai. C'est un numéro de télévision pour eux, un classique dont on parle. Pour un numéro de manipulation sur scène, il s'attendent à ce que le magicien joue sur la vitesse. Donc il faut aller doucement. Ce qui n'empêchera pas de conclure le numéro ou de faire un passage avec une production massive et rapide (attendue !). Combien de fois m'a-ton demandé si je savais faire "le mélange comme ça" en me mimant un accordéon. C'est une image véhiculée par les westerns et les numéros de manipulation mais les gens sont contents de le voir en vrai. C'est l'une des rares fioritures que je présente d'ailleurs en public car je n'aime pas trop montré que je suis habile de mes mains. Je veux préserver la magie. Mais là, c'est un autre débat... On peut discuter de tellement de chose à partir de quelques vidéos. C'est ce qui fait la richesse d'un forum. -
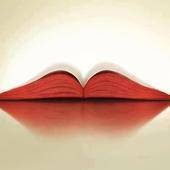
Gus dans Télématin sur France 2 le 080623
Marc PAGE a répondu à un sujet de Christian DELAMORINIERE dans Forum Général
Bien souvent, si. Et c'est normal, nous ne pouvons pas regarder un numéro de magie sans repérer des choses que l'on connaît, même si on le voulait. On considère forcément plus de choses qu'un profane ou tout au moins des choses différentes. La difficulté est d'arriver à faire la part des chose. Se mettre à la place d'un profane est possible, je n'ai pas dis le contraire et j'ai même dit que j'en étais capable, comme d'autres. Mais beaucoup d'entre nous ont du mal se mettre vraiment à la place des profanes pour estimer ce qui leur plaira le plus. Mon avis sur la comparaison de ces deux passages télé (Gus et Kostya Kimlat) est que pour les profanes, le passage de Gus plaira beaucoup plus. On peut le partager ou non mais je suis prêt à parier la dessus parce que je pense savoir repérer ce qui plaît aux profanes depuis toutes ces années. Cela peut paraître prétentieux de ma part mais je le sent. Côté mérite, de mon point de vue, c'est Kostya qui en a le plus car ce qu'il a présenté lui est en partie personnel (il y a mis sa patte, il y a une part de créativité) et techniquement, l'investissement est de toute évidence plus important que pour présenter "Cardtoon". Est-ce que Gus n'est pas un créateur et/ou un bon manipulateur pour autant ? Je ne compare pas les deux magiciens mais les passages télé donc je ne peux pas répondre à cette question. Par contre je sais que Gus est un bon manipulateur parce que je l'ai vu dans d'autres émissions présenter d'autres choses. Il est également capable de mettre un peu plus sa patte qu'ici dans le cadre de la présentation de l'effet de Dan HARLAN. Pour me faire ces avis, j'ai fais appel à mes souvenirs et à mes connaissances qui sont liées au fait que je suis un passionné de magie. Je ne suis donc plus dans le point de vue d'un profane. La situation que tu me décris ensuite, une situation qui t'es personnelle, la naissance d'une passion pour la magie et en particulier la cartomagie, les manipulations fines qui permettent de présenter de belles choses avec un jeu ordinaire est un cas particulier, le tien. Et tu es devenu magicien parce que tu as eu ce regard particulier, parce que tu as été séduit par autre chose ou quelque chose en plus par rapport au profane lambda. Quand je parle de ce qui plairait aux profanes, je raisonne en termes de "ce qui plaira au plus grand nombre", de ce qui marquera le plus les esprits, de ce qu'ils auront envie de raconter le lendemain à leurs proches. Et je suis persuadé que la majorité des téléspectateurs seront plus marqués par un petit bonhomme dessiné sur des cartes qui s'anime et retrouve une carte nommée en direct plutôt que par l'apparition d'un carré à partir d'une carte nommé qui de toute évidence, même si il ne sait pas comment exactement, repose sur l'habilité du magicien. Dans un cas, le spectateur profane apprécie le tour de magie et son originalité (selon lui). Dans l'autre il apprécie plutôt l'habilité du magicien. Lorsqu'au boulot on vient me voir pour me dire "tiens j'ai pensé à toi hier. Il y avait un magicien sur telle chaîne..." C'est amusant de voir les effets qu'on me décrit et comment on me les décrit. Quand après, parfois (pas toujours, je n'ai pas toujours le temps), je regarde le passage télé en question, je vois ce qui a été omis, ce qui diffère entre ce qu'on m'a dit et la réalité. Et au bout de 25ans, je pense commencer à savoir ce qui plaît ou non pour faire mes propres choix dans la construction de mes numéros de scène et de close-up. Donc si je montre ces deux passages télé à des profanes sans rien leur demander, je pense qu'un mois plus tard, si je leur dis "tu te souviens de ce que t'avais montré, les deux magiciens un coup..." , ils se souviendront du "petit bonhomme qui s'anime sur le jeu" mais beaucoup plus difficilement de la carte à l'élastique et de la production du carré par Kostya. Bon, le fait que cette dernière vidéo soi en anglais va jouer aussi mais même sans ça. Je ne vais pas le faire mais je suis persuadé du résultat. -
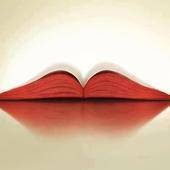
Appearing Glass de Steve THOMPSON
Marc PAGE a répondu à un sujet de Thomas dans Les Étagères Magiques
J'utilisais le "splash bottle" pour l'apparition d'une bouteille sur scène. Aujourd'hui j'utilise une méthode personnelle sans chargeur corporel ni derrière une table ou une chaise pour ne pas me sentir obligé de présenter l'apparition en début de spectacle. Je ne fais d'ailleurs plus apparaître une bouteille mais un seau à champagne rempli de glace avec une bouteille de champagne dedans. Je fais ensuite apparaître une flute de champagne pleine grâce à une combinaison de "Toastmaster" (voir plus bas) et une routine de Mickaël Ammar avec un verre à pied. Je produit aussi parfois une bouteille de champagne et/ou une flûte de champagne à partir d'une feuille de journal en combinant des effets de Pavel et une routine issue du Tarbell mais le côté journal (par rapport au champagne) me plaît moins aujourd'hui même si j'étais content de mes trouvailles. J'ai déjà utilisé "Want a drink" de @Eric LEBLON et "Rocco's glass holder" de Rocco SILANO : - concernant "Want a drink", pas de mauvaise surprise, le gimmick est fiable mais ce n'est pas le mieux adapté pour le table à table (voir plus loin) - concernant le chargeur de Rocco SILANO, ce n'est pas toujours fiable. Le verre peut tomber inopinément et le temps de "décrochage" peut être un poil trop long. Rocco ne l'utilise d'ailleurs pas vraiment pour faire apparaître un verre plein mais juste sortir un verre plein de sa veste. Le gimmick le plus pratique de mon point de vue pour l'apparition d'un verre plein en table à table, le seul qui permette d'ailleurs de répéter l'effet à plusieurs tables de mon point de vue et que j'utilise depuis des années depuis que je l'ai acquis lors d'une conférence est "Toastmaster" de Wolfgang MÖSER car la charge est la plus sécure. Le verre est sur vous, à l'endroit et ne peut pas bouger (encore moins qu'avec les gimmicks cités précédemment). Le gimmick hyper rapide à mettre en place ou à enlever et recharger un verre est tout aussi rapide et peut se faire sans regarder. Le sac en papier est fourni avec mais l'utiliser n'est pas une obligation. Vous allez peut-être trouver le gimmick cher pour ce qu'il est mais détrompez-vous. Il est hyper robuste et sa forme tout comme son revêtement sont adéquat. Comme dirait les américains, c'est pour les "workers". Ici, l'intérêt de la routine de Steve Thompson est la façon dont apparaît le verre qui en semblant tomber de nul part comme le bon vieux gag de clown où on claque des doigts pour faire apparaître un objet dans un sac en papier mais la charge reste corporelle et je ne sais pas si le gimmick peut être rechargé aussi rapidement que "Toastmaster" et je n'ai pas d'intérêt à tester un nouveau gimmick, étant content de "Toastmaster". Je précise que lorsque suis en close-up de table en table, j'ai deux numéros (deux enchaînements de trois routines), un dont le matériel est réparti au niveau de mes poches gauches (poche intérieure droite de veste, poche droite de pantalon mais elles ne sont jamais pleines toutes les deux) et un dans mes poches droites (poche intérieure droite de veste et poche droite de pantalon) + pochette de veste (devant). Je présente ces deux numéros en alternance : une table voit le premier numéro, la suivante l'autre, etc... Toutes mes routines sont "reset" lorsque je les termine (je les choisi ainsi, les modifie pour qu'elles le soient si besoin ou les créer avec cette contrainte imposée) à quelques exceptions près (des routines qui ne sont pas "reset" à la fin mais que je vais préparer de nouveau au travers d'une routine que je vais présenter à la table d'à côté). Je procède ainsi afin que les spectateurs ne voient pas ce que je vais leur présenter d'avance à la table d'à côté. D'autre part, il ne faut pas oublier qu'en dehors du plaisir de voir de la magie, l'autre plaisir des spectateurs est de se raconter ce qu'ils ont vu. Je vous explique ma façon de passer aux tables pour que vous compreniez mieux comment je peux me permettre, grâce à "Toastmaster", de le refaire plusieurs fois lors d'un close-up. Je fais apparaître la flûte au foulard (plus élégant que le sac je trouve), je trinque, je trempe les lèvres légèrement mais je ne bois rien, je salue, me retourne pour passer à la table suivante en remettant le foulard dans ma pochette de veste et je remet directement la flûte en place dans son gimmick (sous couvert du foulard) puis je saisi un premier objet (ou non, selon le cas) pour le numéro à la table suivante (qui ne verra pas l'effet de l'apparition de la flûte mais aura droit à l'apparition d'une rose; j'en ai 4 sur moi donc entre ça et la fûte, je couvre 8 tables ou groupes, le nombre de table moyen lors d'un close-up). Je fais de nouveau l'apparition de la flûte à la table suivante. A la table suivante on me voit donc arriver avec ma main droite tenant un objet (ou pas selon le cas) et ma main gauche qui finit d'enfoncer le foulard dans ma pochette de veste. Ce foulard sert également pour une routine du second numéro (carte à travers le foulard ou disparition du sel au FP souvent). Après, comme pour tous les effets, il faut bien choisir son emplacement à la table pour chaque apparition de ce genre. Durant un numéro je vais changer de place au moins une fois, surtout si ce sont des grandes tables, afin que tout le monde me voit de près à un moment. Dès le début je sais où je me placerai pour les routines où il faut faire attention aux angles. Pour les tables vraiment centrales, je ne fais pas d'apparition de rose mais la flûte, c'est possible). Il est courant qu'on vienne me voir pour me dire "vous pourriez nous montrer telle ou telle chose que vous avez fait à la table d'à côté ?". Dans ce cas, je vais à leur table et leur présente ce que je réserve en pareil cas dans ma poche à briquet de veste (en bas à gauche pour ceux qui se demande où c'est) en leur disant : "Chaque table à sa petite exclusivité, je vais donc vous présenter ce que je n'ai présenté à aucune autre". Et je présente l'une des trois routines réalisables avec ce que j'ai dans cette poche à briquet. Mais je ne vous dirait pas quoi, c'est une surprise pour mes spectateurs et son contenu varie d'ailleurs parfois aussi (on se lasse parfois, il faut se renouveler un peu même si on a toujours des bébés qu'on chouchoute pendant des années). Voilà pour mon expérience en ce qui concerne ce genre d'apparition dans les situations précises décrites (scène /close-up). J'espère vous avoir convaincu pour Toastmaster et peut-être vous avoir donné deux trois tuyaux dans la gestion du matériel et de la charge ou recharge pour ce genre d'effet. Pour ajouter une chose (mais je n'ai jamais essayé), il y a les apparitions avec différents topit, la production à la manche simple et efficace popularisée par David Stone et quelques autres que je garde pour moi car peu connues et rigolotes (et il faut bien que vous cherchiez un peu !) mais allez fouinez du côté de Jay SANKEY, David REGAL, PAVEL, ... et puis n'hésitez pas à cogiter pour en trouver une nouvelle qui soit amusante et pratique à la fois ! Lionel, quitte à le faire une seule fois à la table des mariés ou sur scène (vu que tu envisages d'opter pour 3 apparitions : verre, paille géante et ombrelle), autant sortir une vraie ombrelle à apparition ou en sortir une petite puis la reprendre en disant "elle était rouge sur la photo !" et la transformer en vraie ombrelle. Avec le bruit du déploiement, surprise garantie. "Oui, c'est vrai que ça tape ici !" Et en tenant l'ombrelle pour te faire de l'ombre, tu bois le verre et tu t'en vas en disant "Je vous laisse avec votre rayon de soleil, mes félicitations et à bientôt !"
-
Qui est en ligne (en orange les membres du Cercle VM) - 13 membres, 0 anonyme, 221 invités Afficher la liste
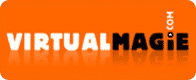
.jpg.f3676384ca95bdad420aee412a56866d.jpg)
.jpg.595b85635aa378e9a2d87bcac46b3adb.jpg)