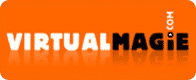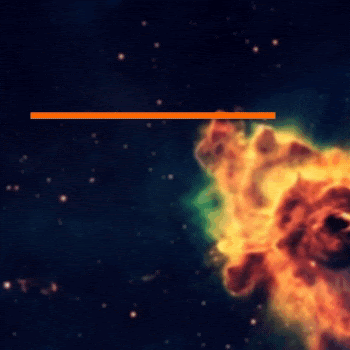-
Compteur de contenus
169 -
Inscription
-
Dernière visite
Tout ce qui a été publié par Fred RAZON
-
dieu seul le sait !!!!!!
-
ne croyez vous pas qu'un nom de scène sonne bien ( a 70%environ ) en fonction de l'estime que l'on a pour son porteur??? est ce que ça ne serait pas a soit même de de rendre son nom populaire et facile a retenir ? prenez David Coperfield , n'aurait il pas le même succès si il s'appelait Jonathan Smith !?
-
quoi ???se mordre la queue ??
-

Pickpocketisme : le rendre magique, le pratiquer...
Fred RAZON a répondu à un sujet de Fred RAZON dans Forum Général
c'est pour ça qu'il faut vachement s'entraîner a la maison , puis sur ses amis ( que l'on perd très vite a force de les les soûler ensuite traîner dans les bars pour s'entraîner sur les ivrognes après on passe aux maisons de retraites ... et après on peut inclure quelques passes dans le close-up .... et après tout ça , si tu te fais prendre la main dans la poche , tu ferme ta mallette , tu fini ton verre et tu cours le plus vite possibllllle...........! :grin: -
et l'émotion change la percetion!!! ohlala , on s'mort la queue !!
-
appelez moi Friedrich razon !!! lol
-

[Réflexion] Impression de Cartes à Jouer
Fred RAZON a répondu à un sujet de Thomas dans Forum Général
j avais deja appelé mais si mais souvenir son bon ils font pas moins de 5000 minimum !!! -
Quand un avion vole au-dessus de notre tête en ayant passé le mur du son, on entend une détonation, communément appelée « bang ». On peut alors imaginer que la déflagration n’a lieu qu’une fois, au moment de ce fameux « bang ». Et bien non. Pendant tout le temps où il vole à Mach 1 (ou plus), le frottement du corps de l’avion repoussant une grande quantité d’air à une vitesse élevée, fait que le bruit est permanent Le mot « bang » ne correspond donc pas à ce qui est réel mais à une adaptation due à la façon dont notre cerveau perçoit la chose sur la base de ce que nous entendons. ahhhhhhhhh !!!!!!!!!!
-
ce soir grand spectacle de phylo avec otto au palmier dans le marais !!!!! on va pouvoir approfondir le sujet !!!
-

Pickpocketisme : le rendre magique, le pratiquer...
Fred RAZON a répondu à un sujet de Fred RAZON dans Forum Général
oh ouiiiiiii apprends moi !!!!mon maxou qui soit dit en passant est plus doué en close-up qu'il ne laisse pensser!!!! a demain soir mon maxou !! :blush: -

Pickpocketisme : le rendre magique, le pratiquer...
Fred RAZON a répondu à un sujet de Fred RAZON dans Forum Général
on dira ce qu'on voudra , mais moi j'aime bien majax !!!en pickpocket -

Pickpocketisme : le rendre magique, le pratiquer...
Fred RAZON a répondu à un sujet de Fred RAZON dans Forum Général
oui et ? -

Pickpocketisme : le rendre magique, le pratiquer...
Fred RAZON a répondu à un sujet de Fred RAZON dans Forum Général
je suis tout a fait d'accord avec toi !!!gégé!! -

Pickpocketisme : le rendre magique, le pratiquer...
Fred RAZON a répondu à un sujet de Fred RAZON dans Forum Général
lol je parlais de quelque chose de serieux" Mastering the art of pickpocketisme" excuse moi mais c'est pas vraimment extra !! lol -

Pickpocketisme : le rendre magique, le pratiquer...
Fred RAZON a répondu à un sujet de Fred RAZON dans Forum Général
bien ! qui connait de bonne chose pour apprendre le pickpocketisme ( livres,dvd,...etc)? -

Pickpocketisme : le rendre magique, le pratiquer...
Fred RAZON a répondu à un sujet de Fred RAZON dans Forum Général
lol je croyais que c'etait moi !!!! ptdr -

Pickpocketisme : le rendre magique, le pratiquer...
Fred RAZON a répondu à un sujet de Fred RAZON dans Forum Général
maitenant ce que propose Romaric ,c'est tres bien , mais je voulais parler de pickpocketisme un peut plus approfondit , dans le genre portefeuille ... pas seulement les montres en cuir que tous savons picker ;et qu il ne suffit pas de savoir prendre la montre sur un spectateur qui ne se doute de rien du tout et mettre "pickpocket" sur sa carte de visite ! ex: tout le monde sait faire une donne en second : c'est pour ça que l'on note tricheur sur sa carte ! -

Pickpocketisme : le rendre magique, le pratiquer...
un sujet publié par Fred RAZON dans Forum Général
Hello, hello Comment rendre le pickpocketisme magic !? Comment apprendre le pickpocketisme et où ?! La technique est elle si importante ? Arriver a un impact maximum ! …..etc !!! Autant de points a travailler pour pouvoir ecrir pickpocket sur sa carte de visite ! A vos doigts , pret clavier !!! -
non je parlais du systeme avec les cartouches d'acide chlorhydrique + amoniac ....ki bouffe les tissus des costumes !
-
on a tout a fait le droitr de vendre ce type d accessoires comme ils on le droit de venfre des plaques de plices, ou de multiples objet ds l genre ; le truc c'est ils on le droits de les vendre ,on a l droit de les acheter , mais on a po l droit de s en servir !!!!
-
et les trous noir, alors?
-
ahhhhhhhh !!!ma fille dit quelque chose !!!au nom du marais!!!
-
et si tout cela etait faut !!! st si on se trompait!! et si....................................nous étions dans la matrix!!!!!!!!!! on est dans la merde!!
-
c'est l meme principe que smoke 2000?
-
(a) La vérité est l'attribut de ce qui est vrai. Aristote est considéré comme le fondateur de ce que l'on nomme, depuis Alfred Tarski , la conception sémantique de la vérité et de l'erreur : - <<Dire de ce qui est qu'il est, ou de ce qui n'est pas qu'il n'est pas, c'est dire vrai ; dire de ce qui n'est pas qu'il est ou de ce qui est qu'il n'ets pas, c'est dir faux. (Aristote)>>. (b) Cete notion n'a de sens qu'à l'intérieur de chacune des Mathématiques. Et ce qui est vrai dans l'une d'elles pourra être faux dans d'autres. En dehors, la vérite est l'illusion de la possibilité d'une connaissance totale à laquelle donne accès lz découverte de l'ignorance et celle du mensonge. En supprimant l'ignorance et le mensonge, on accéderai tà la vérité sur la réalite. © Paradoxe apparent. "A la vérité, il n'y a pas de vérité". A la vérité (sens <b>, à la suite d'un processus de découverte), on s'aperçoit qu'il n'y a pas de vérité (sens <a>, qui serait déjà là, dans une adéquation de la pensée avec la matière). (d) Il n'y a pas de vérité absolue. <<Il n'y a qu'une vérité absolu e, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue (Jules Lagneau, cité par son élève, Alain ou Emile Chartier)>>. Pourtant il existe une réalité unique. Mais elle n'est pas directement connaissable ni formulable. Le message q ui saurait exprimer la vérite absolue de l'Univers aurait probablement une dimension comparable à celle de l'Univers. Le temps nécessaire pour le lire et l'assimile r ne serait pas à l'échelle de la vie humaine. Et il faudrait bien vivre, dans l'approximation ou dans l'erreur, en attendant. (e) La philosophie de la connaissance distinngue la vérité logique, la cohérence du discours, l'absence de contradictions ; de la vérité matérielle ou de la pertinence scientifique, le fait qu'un énoncé ait été expérimentalement établi ou vérifié. (f) La vérité logique ou formelle exprime l'accord de la pensée avec elle-même (la cohérence), la vérité matérielle l'accord de la pensee avec les choses (la pertinence). Tandis que les idéalistes ramènent volontiers la vérité matérielle à la seule vérité formelle, les réalistes rappelllent que plusieurs systèmes de pensée, cohérents en eux-mêmes, peuvent être incompatibles entre eux. (g) Pour choisir entre eux, la pensée doit se référer à une réalité extérieure à elle-même (une réalité indépendante ou un référent lointain). Il ne peut donc pas y avoir de vérité matérielle au niveau des principes généraux .Les critères de la pertinence seront particuliers à chaque domaine. D'où le retour de la particularité préalablement réduite par l'abstraction comme exclusion. Et d'où la nécessité de plusieurs représentations toutes cohérentes mais construites avec les divers points de vue possibles. (h) Aujourd'hui, après la multiplication des disciplines scientifiques, de leurs objets et de leurs méthodes, c'est l'ensemble du cadre théorique et de son instrumentation qui est astreint à la réfutabilité. Il est soumis à la réfutation de ses conjectures. (i) Par une inévitable récursivité des questions, c'est l'ensemble de la science, y compris la linguistique et la sémantique, qui participe à sa propre critique. (j) Il n'y a donc pas de Critère de la vérité, contrairement à l'argument d'autorité du dogmatisme. (k) Psychanalyse historique. La croyance en une vérité, rapidement accessible, est certainement ce qui séparait Georg Groddeck, médecin allemand, des "croyants" qui entouraient Sigmund Freud. Groddeck avait une vision chaotique du Ça. Il se méfiait des théories trop cohérentes des "savants à lunettes". - <<Vous le voyez, pour peu que je m'en donne la peine, je suis capable de trouver de passables raisons à mes erreurs. Mais je répugne à ce genre de procédé. Je m'octroie le droit de me tromper, quand ce ne serait que parce que je tiens la vérité et la réalité pour des biens douteux. (Georg Groddeck, Le livre du Ça, page 268)>>. - <<Soyons catégoriques, il ne s'agit pas dans l'anamnèse psychanalytique de réalité, mais de vérité (Jacques Lacan, "Fonction et champ de la parole et du langage", in "Ecrits")>>. (l) Une des raisons pour lesquelles la Science a une chance de progresser, entre la Religion et la Politique, c'est que les illusions qu'elle traque (y compris les siennes) sont, par bonheur, incompatibles entre elles. La vérité est toujours bonne à dire, mais cette diction est un acte courageux. mais bon pourquoi s prendre la tête!........
-
Qui est en ligne (en orange les membres du Cercle VM) - 10 membres, 0 anonyme, 99 invités Afficher la liste